-
Par Lybertaire le 14 Juillet 2015 à 16:27

L’Adversaire
Emmanuel Carrère
P.O.L.
2000
Emmanuel Carrère raconte l’histoire retentissante de Jean-Claude Romand qui, en 1993, a tué toute sa famille après l'avoir trompée et escroquée pendant dix ans en se faisant passer pour un médecin de l’OMS.« Toute la vérité : dix-sept ans de mensonges1 ? »
En 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses deux enfants et ses parents avec une froideur hors norme. L’enquête policière a mis au jour une réalité monstrueuse et troublante, libérant par là-même le meurtrier : depuis presque vingt ans, il se faisait passer pour un chercheur réputé de l’OMS, fréquentant des personnalités médiatiques et assistant à des conférences internationales sur la médecine.
Pourquoi ce coup de folie, cet acte impensable, insensé, horrible ? Emmanuel Carrère explique comment il a été amené à écrire un livre sur cette histoire et fait un récit détaillé du procès. Point par point, il reconstitue, comme l’ont fait les enquêteurs et l’entourage, toute une vie de mensonges, de solitude destructrice, de dépression silencieuse, une coquille vide qui lui était devenue insupportable.
« Ç’aurait dû être doux et chaud, cette vie de famille. Ils croyaient que c’était doux et chaud. Mais lui savait que c’était pourri de l’intérieur, que pas un instant, pas un geste, pas même leur sommeil n’échappaient à cette pourriture. Elle avait grandi en lui, petit à petit elle avait tout dévoré de l’intérieur sans que de l’extérieur on voie rien, et maintenant il ne restait plus rien d’autre, il n’y avait plus qu’elle qui allait faire éclater la coquille et paraître au grand jour. Ils allaient se retrouver nus, sans défense, dans le froid et l’horreur, et ce serait la seule réalité. C’était déjà, même s’ils ne le savaient pas, la seule réalité2. »
Pour finir
Emmanuel Carrère raconte très bien. Il est parvenu à construire un récit bien composé, à la fois factuel et nourri d’impressions, entre l’empathie naturelle et le réalisme, sans pathos ni jugement moral excessif, malgré un sujet si délicat.
L’exercice est terrible pour l’écrivain, chercher à comprendre le criminel tout en se positionnant du point de vue de l’entourage ; d’autant plus difficile pour Emmanuel Carrère qui partage la foi chrétienne dans laquelle Jean-Claude Romand s’est réfugié pendant sa réclusion. Mais le résultat est passionnant, convaincant et se lit presque d’une traite.
L’Adversaire, un récit vertigineux qui met mal à l’aise. Le procès, qui nourrit cette part malsaine en chacun de nous, ce voyeurisme, dévoile les pans les plus intimes de la vie des victimes. Les médias ont du également s’en donner à cœur joie. On veut comprendre, mais on ne veut pas savoir. On se met à la place des uns et des autres, de ceux qui ont partagé le quotidien de Jean-Claude Romand et qui n’ont rien deviné durant toutes ces années, et à la place de l’écrivain qui s’implique.
« Il est facile de considérer Romand comme un monstre et ses amis comme une bande de bourgeois de province ridiculement naïfs quand on connaît la fin de l’histoire3. »
Alors, en faire un récit, et qui plus est un film (L’Adversaire, Nicole Garcia, 2002), c’est aussi donner prise aux désirs mythomanes de Jean-Claude Roman d’être quelqu’un. Perpétuellement dans une mise en scène de soi, Romand est entré dans la postérité en passant du médecin réputé à ce martyr-héros en route pour la rédemption éternelle. Il devient le symbole d’une tragédie à laquelle il a survécu, alors qu’il en est le responsable et le monstre ; il se réfugie (ou se cache ?) dans une foi sans borne pour nier les événements, évacuer une lucidité et une souffrance trop frontales.
Voilà un récit qui m’a beaucoup touché, notamment parce que je le lis en 2015, date à laquelle le monsieur est libérable, et parce que les enfants victimes auraient eu mon âge s’ils avaient survécu.
Lisez aussi
La révolte à perpétuité Sante Notarnicola
1. Page 132. -2. Page 154. -3. Page 187.
L’Adversaire
Emmanuel Carrère
Éditions Gallimard
Collection Folio n°3520
2001
224 pages
6,40 euros 12 commentaires
12 commentaires
-
Par Lybertaire le 13 Mai 2014 à 18:28

Allers-retours
Paris-New York.
Un itinéraire politiqueAndré Schiffrin
Liana Levi
2007André Schiffrin retrace son parcours d’éditeur politique, de son exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’à ses dernières années.
L’homme et l’édition libre
Lorsqu’on parle d’André Schiffrin, on parle surtout de sa carrière d’éditeur aux États-Unis et de celle de son père, Jacques Schiffrin, qui a créé la Pléiade, rachetée ensuite par Gallimard en 1933. Depuis qu’il a publié son premier livre en France, il y a quinze ans, André Schiffrin incarne en France l’édition libre, indépendante des pressions économiques et politiques, et exigeante.
Dans ce récit de souvenirs, Schiffrin revient sur sa carrière de presque trente ans au Pantheon, la prestigieuse maison new-yorkaise où avait également travaillé son père. Il revient sur les auteurs qu’il a publiés et qui sont désormais mondialement connus, comme Noam Chomsky et Eric Hobsbawn. Une à une, les maisons d’édition ont été absorbées par des groupes qui ont fait de leur business non pas les livres mais les maisons d’édition elles-mêmes : entre fusions et rachats, les maisons devaient obtenir 20 % de bénéfice, alors que le secteur tourne autour de 3 %. Quand sa propre maison a été rachetée, il a démissionné et monté en 1991 The New Press, une maison d’édition au statut associatif qui a acquis une grande aura aujourd’hui.
Schiffrin n’a pas seulement revendiqué la nécessité d’une édition libre, mais aussi d’une presse libre. Les médias, télé, presse écrite et web, sont sous le joug de la rentabilité, laquelle exige davantage d’annonceurs publicitaires pour financer l’entreprise. Et qui dit publicité dit besoin d’augmenter l’audience. Et l’exigence d’une plus forte audience passe par la baisse des contenus, devenant de plus en plus spectaculaires, humiliants, violents, haineux, réactionnaires, stupides, réducteurs, falsifiés. Schiffrin prouve par son parcours que ce sont nos médias qui forgent notre représentation du monde.
L’homme et la politique
De Schiffrin, on connaît moins son histoire personnelle. Allers-retours retrace son exil aux États-Unis lorsque son père a été renvoyé par Gaston Gallimard en 1939 parce qu’il était juif. Il raconte sa nouvelle vie à New York et le début de son engagement politique lors du Maccarthysme et de la guerre froide qui ont tué le communiste, et même l’idée du « social », sur le sol américain. Lui-même, de par son histoire familiale et le contexte dans lequel il a grandi, se revendique d’un socialisme modéré.
Son témoignage rappelle combien les États-Unis et l’URSS se sont érigés en souverains par la manipulation et la force armée (en Amérique du Sud pour l’un et en Europe de l’Est pour l’autre). Schiffrin lui-même, en tant que leader de son parti étudiant socialiste, a été financé par la CIA pour aller prêcher la liberté de parole américaine en Europe, à une époque où, justement, l’hystérie anti-communiste ambiante muselait les esprits.
Pour finir
Lorsqu’on parle de Schiffrin, on pense effectivement à l’éditeur qui a pris position pour l’édition indépendante et contre les grands groupes, au Français qui a vécu à New York, partagé entre deux cultures qu’il n’aura eu de cesse d’analyser et de comparer.
On pense moins à Schiffrin issu d’une famille d’intellectuels aisée qui a gravité autour de grands noms, comme Gaston Gallimard, André Gide, Roger Martin du Gard, Hannah Arendt et d’autres ; à celui qui a intégré de brillantes universités par cooptation et qui a suivi les traces de son illustre père. Si ces souvenirs sont passionnants, plein de perles rares (lorsqu’il rencontre Gide et Gallimard à 13 ans), le parcours de Schiffrin valide néanmoins la théorie bourdieusienne qui érige le capital social en facteur de réussite, ce qui fait forcément écho à l’édition parisienne fermement délimitée par le conservatisme, la cooptation et le snobisme petit-bourgeois.
Schiffrin renvoie à la définition de l’éditeur contemporain : du talent pour sentir les débats publics et aller à la rencontre des auteurs divergents, et la capacité à emmener les siens, éditeurs et auteurs, vers une nouvelle aventure éditoriale. En homme discret, il a écrit des souvenirs politiques empreints de pudeur et de modestie. Il n’a pas évoqué sa vie personnelle mais seulement sa vision du monde, car c’est précisément ce qu’on attend de son témoignage — la vie privée reste privée.
Refermer Allers-retours, c’est remercier une nouvelle fois Schiffrin de m’avoir fait découvrir l’édition et d’avoir donné un sens à mon métier. Écrire cette chronique, c’est lui dire au revoir et regretter de ne pas avoir réussi à le rencontrer. À nous de prendre la relève, de porter haut notre idéal pour que le monde nous écoute.
Du même auteur

L’Édition sans éditeurs
dans Essais
Le Contrôle de la parole 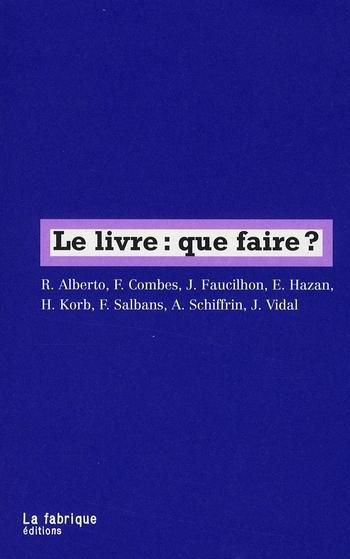
Le Livre : que faire ?
Collectif dont André Schiffrin
dans Essais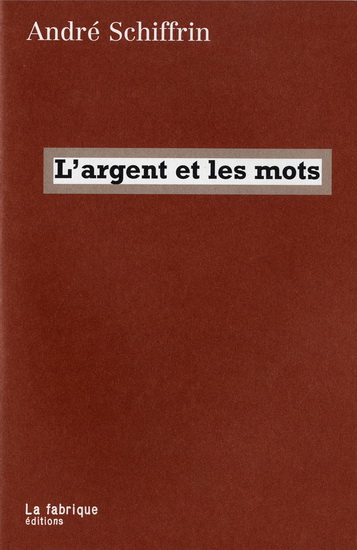
L’Argent et les mots Lisez aussi
La Trahison des éditeurs
dans EssaisAllers-retours
Paris-New York. Un itinéraire politique
André Schiffrin
(A Political Education, titre original)
Traduit de l’anglais par Franchita Gonzalez Batlle
Éditions Liana Levi
2007
288 pages
22 € 2 commentaires
2 commentaires
-
Par Lybertaire le 25 Août 2013 à 11:36

Petits bonheurs de l’édition. Journal de stage
Bruno Migdal
Éditions de la Différence
2005
« L’édition, c’est 99,9% de pesanteurs et 0,1% de magie1 »
Bruno Migdal est entré dans l’édition par la petite porte (la seule qui semble aujourd’hui possible même avec le piston) : durant trois mois, il a été stagiaire dans une maison d’édition. Sauf que l’auteur, qui nous livre son journal de stage, jour après jour, a plus de quarante ans et exerçait auparavant un métier tout à fait différent.
Si le nom de la maison n’est jamais donné, on le devine bien vite, car Bruno Migdal donne avec malice plein d’éléments dans les trois premières pages, puis en distille d’autres au fur et à mesure (noms d’éditeurs et anecdotes sur les auteurs). Ainsi, chez G., il a travaillé au service éditorial où il s’est vu confié la tâche que les éditeurs refilent toujours aux stagiaires débutants : lire les manuscrits reçus par la poste. Et, il y en a beaucoup, beaucoup. Plusieurs milliers par an pour les plus grandes maisons d’édition, et 5000 pour G. Pourtant, si la tâche est fastidieuse à la longue, elle apprend au futur éditeur son rôle de gatekeeper : maintenir la frontière entre ce qui est publiable et ce qui reste du domaine privé. Sur les traces de Françoise Verny qui, paraît-il, aurait terminé sa carrière au même endroit, à lire des manuscrits et boire du whisky en même temps, Bruno Migdal consacre une grande partie de son rapport à cette problématique passionnante, et par laquelle nous sommes passés si nous avons fait le même genre de stage : comment définit-on le talent ? comment définit-on ce qui mérite d’être lu par tous et ce qui relève de l’écriture personnelle ? et comment répondre aux auteurs ?
« Beaucoup de manuscrits postulent un présupposé du lecteur, qui les dispense de poser un décor, d’asseoir un personnage - la description et l’étude psychologique lourde ont fait long feu : comme nous savons très vaguement tout sur tout - ce qui est commode - nommer suffit, l’air du temps apportant le liant et assurant l’ancrage dans une réalité prosaïque qui coule de source. Plus guère de souffle, plus de travail préparatoire, ni documentaire, l’autofiction autoréférencée à la petite semaine fournit la matière : je sortis à Saint-Placide, remontai la rue de Rennes, m’engouffrai dans la Fnac. Qu’y percevrait un Huron - lisant le français ? La fiction y perd son pouvoir d’évocation, au profit d’une désignation desséchante, inerte et sans prolongement, où l’imaginaire est tué dans l’œuf2. »
La question est tout autant essentielle que stratégique, car il s’agit de trouver de nouveaux talents pour intégrer le catalogue de la maison d’édition. Elle devrait donc être confiée aux éditeurs, mais il n’en est rien : pourquoi confier la tâche aux stagiaires ? Parce que les écrivains talentueux (et publiables) qui envoient leur texte par courrier, sans passer par un contact au sein de l’entreprise, se font rares (en moyenne, 1% de la production annuelle...) ; la rareté des perles en fait un travail long et rébarbatif tout à fait adapté aux fonctions du stagiaire.
« Le stagiaire est un être ductile, sans fierté3. »
Heureusement, Bruno Migdal a pu apercevoir d’autres pans du service éditorial, à savoir la correction et la relecture d’épreuves. Ce sont des tâches un peu moins fastidieuses : notre Bruno monte en grade, c’est sûr ! Dans un milieu où les éditeurs sont particulièrement attachés à leurs livres et à leurs auteurs, les stagiaires de l’éditorial ont en effet des difficultés à se voir confier des projets importants ; et malgré son âge, Bruno Migdal est traité comme les jeunes stagiaires de vingt ans. D’une manière générale, on a peu de temps à consacrer aux « petites mains », surtout lorsqu’elles occupent le plus bas de l’échelle professionnelle et sociale. Les stagiaires de l’éditorial sont payés - et ce dans la quasi totalité des maisons, grandes ou petites - le minimum légal (avec quelques livres en cadeau tout de même), soit 436,05 € par mois pour l’année 2013. Mais « j’aurais payé pour être là4 » affirme Bruno. Pourtant certains étudiants, tout aussi passionnés que lui par le livre, refusent de faire de longs stages parce qu’ils doivent enchaîner avec un petit boulot pour payer le loyer. Lire ne nourrit que l’esprit.
« Le midi, ceux qui n’ont pas leur rond de serviette chez Lipp ou aux Deux Magots et qui forment l’essentiel du petit peuple sans lequel l’édition n’existerait pas, se réchauffent un surgelé dans une minuscule pièce sans air et sans fenêtre. Et comme tout le monde fume dans ce milieu, j’ai beau chercher à privilégier le relationnel, les exigences physiologiques sont là : migraineux, les yeux larmoyants à la fin du repas, je décide la mort dans l’âme de me soustraire à ce rendez-vous. Au vrai, personne ne prend ombrage de ma défection : passée la première curiosité, je fais déjà partie du mobilier et, je l’espère aussi, un peu de la famille5. »
Toutefois, tous les stages ne se ressemblent pas, ni les entreprises. Derrière la passion pour la lecture et une certaine convivialité qui font office de paravent, on retrouve le côté hautain, particulièrement dans les grandes maisons où la pression des auteurs est forte (il est en effet difficile de refuser le manuscrit d’un auteur déjà publié par la maison). Ici comme ailleurs, on croise des personnalités suffisantes, voire exécrables, et d’autres tout à fait charmantes. On croise par exemple BHL, propulsé par Françoise Verny citée plus haut, ou plutôt ses portraits en chemise blanche sur les murs.
Mon avis
Agréable à lire parce qu’il ouvre une porte sur un milieu à la fois grand (par son prestige et sa magie) et petit (parce que peuplé de 13000 âmes en France environ), Petits bonheurs de l’édition souffre toutefois de quelques défauts. En premier lieu, le ton utilisé, s’il relève effectivement du journal, est souvent difficile à déchiffrer, avec des tournures de phrases alambiquées et l’emploi de termes compliqués juxtaposés les uns aux autres, lesquels donnent un aspect tantôt cynique, tantôt pédant. Par ailleurs, on attend davantage de détails, à la fois sur la manière de travailler, sur la maison elle-même et sur les autres services. L’occasion de fournir tous ces éléments s’y prêtait puisque c’est un « journal de stage », mais le fait que la maison soit connue a peut-être été dissuasif. Du reste, c’est un demi-défaut puisque Bruno Migdal n’a probablement pas eu la prétention de pousser l’exercice jusqu’à l’analyse approfondie : pauvres lecteurs, nous resterons sur notre faim !
Lisez aussi
L’Édition sans éditeurs André Schiffrin
Allers-retours André Schiffrin
L'édition indépendante critique Sophie Noël
Édition. L'envers du décor Martine Prosper
Les Intellos précaires Anne et Marine Rambach
Les Nouveaux Intellos précaires Anne et Marine Rambach
Tant qu'il y aura des livres Laurence Santantonios
La Trahison des éditeurs Thierry Discepolo
Le livre : que faire ? Collectif
La Condition littéraire Bernard Lahire
Journalistes précaires, journalistes au quotidien Collectif
Boulots de merde ! Julien Brygo et Olivier Cyran
Correcteurs et correctrices, entre prestige et précarité Guillaume Goutte
Black Girl Zakiya Dalila Harris
1. Propos de Viviane Hamy, cité dans « Viviane Hamy, l’amazone de l’édition », Luc Chatel, Témoignage chrétien, 18 mars 1999 no2854, page 12. -2. Pages 53-54. -3. Page 74. -4. Page 62. -5. Page 19.
Petits bonheurs de l'édition. Journal de stage
Bruno Migdal
Collection Littérature
2011
144 pages
10,15 euros
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
 2 commentaires
2 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Léchez-moi lire !





