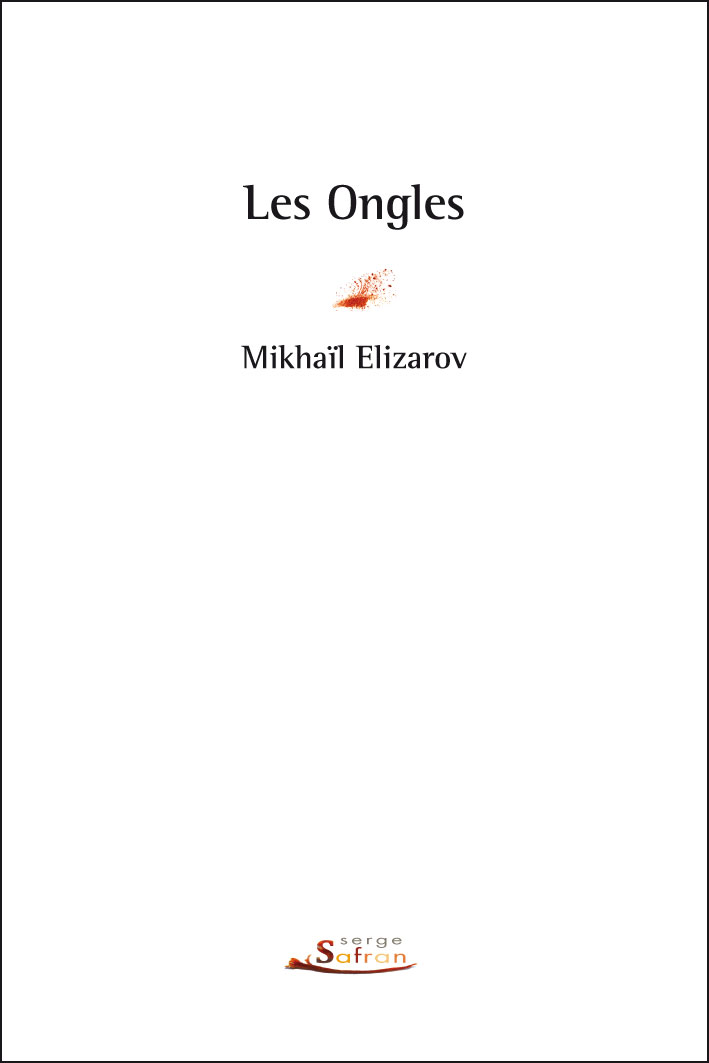-
Oubliettes
Les œuvres qui figurent dans cette rubrique manquent d’originalité ou sont construites de manière maladroite. Certaines ne manquent de rien mais après avoir refermé le livre, je me suis rendu compte qu’il n’en reste pas grand chose — ni émotions, ni souvenirs.
-
Par Lybertaire le 5 Décembre 2016 à 19:29

L’Attentat
Yasmina Khadra
Éditions Julliard
2005
Dans le but de laisser une seconde chance à cet auteur, dont la chronique de Ce que le jour doit à la nuit a été la troisième sur Bibliolingus et la première à inaugurer la rubrique Oubliettes, j’ai décidé de lire son œuvre la plus connue. J’explique une fois encore pourquoi j’ai été déçue par l’histoire et le style pompeux, même si le thème du conflit israélo-palestinien m’interpelle.
« Cela ne lui disait rien de prendre le taureau par les cornes et lorsqu’il tirait le diable par la queue, il n’en faisait pas une galère. »
Vous trouvez cette phrase moyenne ? Moi aussi, comme l’ensemble du roman.
Amine Jaafari, d’origine arabe mais naturalisé israélien, est un brillant chirurgien, bien intégré et vivant dans un beau quartier de Tel-Aviv avec son épouse Sihem. Mais sa vie bascule lorsqu’un attentat éclate dans un restaurant car il s’avère que le kamikaze n’est autre que son épouse.
Il tombe des nues car il n’avait jamais soupçonné qu’elle puisse être fanatique : elle a embrassé la cause palestinienne alors que, de son côté, il avait fait en sorte d’évacuer la religion et la politique de sa vie. Le voilà rattrapé par l’histoire de son peuple et le conflit israélo-palestinien. Il tente alors de comprendre ce qu’il s’est passé dans la tête de son épouse.
Rencontre avec le livre
Le thème était pourtant crucial, mais le style de Yasmina Khadra m’insupporte. Comme dans ma précédente lecture, je retrouve les mêmes défauts narratifs : une situation initiale banale (l’homme qui a réussi sa vie et qui la voit se fissurer, comme s’il n’avait rien vu venir), des rebondissements peu nombreux (heureusement que le livre est assez court), et une fin prévisible (amorcée par le texte d’intro). Quant au style, hormis l’abus des points de suspension et les retours à la ligne censés créer le suspense, les descriptions sont pompeuses, précieuses, grandiloquentes (« un frisson me griffe le dos avant détendre sa reptation furtive jusque dans ma poitrine »), faites pour être citées, comme si l’auteur aimait se regarder écrire de pseudos belles phrases (comme les gens qui aiment s’écouter parler, vous voyez ?).
Il y a aussi ce travers qui consiste à exposer les faits au lieu de les traduire en acte : par exemple, au lieu de créer une scène d’amitié complice autour d’un dialogue, il écrit que les personnages partagent une « formidable amitié », ce qui ne donne pas le même effet. Ça donne l’impression de lire un scénario très descriptif plutôt qu’un roman avec des personnages, des émotions, des actions, et ça enlève toute chair et crédibilité à l’histoire.
Voilà, Yasmina Khadra n’est décidément pas pour moi et je m’en tiendrai là. Toutefois le cadre historique et religieux m’intéresse et j’aurai sûrement l’occasion de lire d’autres romans ou ouvrages sur le conflit israélo-palestinien.
Du même auteur
Lisez aussi
Les Français jihadistes David Thomson
Ce que tient ta main droite t'appartient Pascal Manoukian
Terroristes Marc Trévidic
Terreur dans l'Hexagone Gilles Kepel
L’Attentat
Yasmina Khadra
Éditions Pocket
2011
256 pages
7,40 euros
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par Lybertaire le 27 Septembre 2016 à 19:34

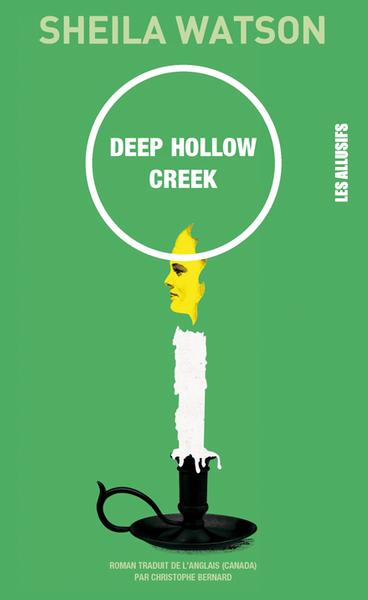
Deep hollow creek
Sheila Watson
Éditions Les Allusifs
2016
En un mot
Ce roman canadien écrit dans les années 1930 raconte l’arrivée de Stella, une institutrice, dans un hameau de paysans et d’éleveurs. Elle y contemple la nature rude et les voisins non moins rustres, pudiques et solitaires. Un roman qui se veut peut-être moderne mais qui m’a paru particulièrement abscons et assez radin dans l’économie des mots et des explications.
« Et personne ne va voir Rose, dit-elle. Personne1. »
Stella, institutrice, s’installe dans un hameau en Colombie-britannique (à l’ouest du Canada) dans les années 1930. Dans cette région peuplée de coyotes et de tétras, on vit au rythme de la nature, avec des hivers rudes et interminables. Les colons, qui côtoient les indiens avec circonspection, vivent de l’agriculture, de l’élevage des bœufs et des chevaux.
Dans le hameau, les commérages occupent les habitants, et surtout Mamie, un peu pingre et mesquine, qui de son salon joue à la femme de bonne société. Il y a son mari, le taciturne Bill, son frère Sam et son épouse Rose qui est très isolée ; le marchand Mockett, mais aussi Nicholas Farish, l’ami des indiens.
Rencontre avec le livre
Ce roman dont j’ai entendu un résumé alléchant a été une déception. La lecture a été plus laborieuse que plaisante et pas très captivante.
Il n’y a effectivement aucune contextualisation de temps et de lieu, ni même des personnages. Le personnage principal, Stella, est presque invisible : elle observe la vallée, la nature, écoute les voisins au langage tantôt brusque ou pudique et se ressource dans des soliloques de citations littéraires obscures. D’ailleurs, j’ignore toujours qui elle est, d’où elle vient, et pourquoi elle a choisi cette région reculée pour enseigner. Des personnages sont cités ou apparaissent au hasard des pages, dans la narration ou dans un dialogue (lesquels n’ont pas de tirets d’incise, ça fait avant-gardiste^^) : on devine difficilement qui ils sont, et leurs relations restent assez absconses. On reste dans un flou constant, une forêt de non-dits ; et l’impression d’un texte statique, décousu, est entretenue par la succession de très courts passages elliptiques dans lesquels les personnages sont posés là, sans mouvement, sans déplacement dans l’espace.
Au final, je trouve qu’il y a une forme de radinerie dans l’économie des mots et des explications. Peut-être que ça fait mystérieux et talentueux mais moi je trouve ça illisible. Pourtant il y avait des choses à explorer : la solitude de cette femme qui force l’émancipation, son goût passionné pour la lecture, la rudesse de ses voisins, la relation avec les indiens et les animaux…
Comme toujours lorsque je suis face à un texte aussi abscons, je lis deux à trois fois chaque paragraphe. J’ai eu beau lire et relire, le sens profond du texte m’a certainement échappé, mais je crois aussi que l’auteure n’a pas cherché à se rendre « publique », même si l’éditeur affirme que c’est un classique de la littérature canadienne. Heureusement que le livre était court car je n’ai pas pris de plaisir à le lire. Dommage, car le catalogue des éditions Les Allusifs est par ailleurs très intéressant.
1. Page 18.
Deep hollow creek
(titre original)
Traduit de l’anglais (Canada) par Christophe Bernard
Sheila Watson
Éditions Les Allusifs
2016 (années 1930 pour l’écriture et 1992 pour la première publication)
150 pages
12 euros 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Lybertaire le 1 Novembre 2014 à 13:15
Les Ongles
Mikhaïl Elizarov
Serge Safran éditeur
2014
Gloucester et Bakatov, deux jeunes inséparables qui ont grandi à l’orphelinat pour enfants handicapés, découvrent la société post-soviétique.
« Je suis venu au monde bossu, fruit de l’égoïsme, de l’irresponsabilité aussi, chapitre d’un curriculum d’ivrognes, produit d’un appareillage d’oto-rhino bon pour la casse1. »
Le premier, Bakatov, a le crâne déformé. Le second, Gloucester, est bossu et nous raconte leur histoire. Inséparables, solidaires en tout, ils ont grandi dans un orphelinat de banlieue, abandonné par les pouvoirs publics. Toute leur vie, les enfants de l’orphelinat, handicapés, attardés mentaux ou simplement trop laids pour être aimés, n’ont connu que la maltraitance et les humiliations, parqués comme des bêtes sans stimulation intellectuelle ni activités ludiques.
Mais dans cette vie rude, l’un et l’autre ont développé un don hors du commun. Bakatov manifeste des pouvoirs étranges grâce à des incantations pendant lesquelles il se ronge les ongles. Quant à Gloucester, il a la bosse de la musique, au sens propre. Intelligents et autodidactes, ils savent de temps en temps tourner à leur avantage le fait d’être considérés comme des débiles.
À dix-huit ans, ils sont lâchés en ville. Les voilà embarqués dans le monde qui leur est totalement inconnu. La chance leur sourit, du moins pour un temps.
Pour finir
Dans les romans courts, soit l’effet est saisissant et fulgurant, soit il tombe à l’eau. Le potentiel était pourtant énorme. Imaginez un orphelinat russe, un de ceux qui peuplent notre vision de la Russie soviétique qui rationalise l’existence humaine ; prenez ces deux enfants, extrêmement doués, presque surnaturels, soudés dans la galère et le mépris. Mais leur ascension et leur chute est si prompte que leur souvenir s’efface bien vite après avoir refermé le livre, d’autant que la fin est étrange et bâclée. Les thèmes (la discrimination par l’intelligence et la différence, l’abandon) aussi sont à peine effleurés, insuffisamment exploités.
Surtout, Les Ongles est un (premier) roman agaçant à cause de son style recherché, voire précieux, composé de périphrases appelant des mots savants2, et haché par une ponctuation qui laisse perplexe3. La mise à distance à coup de périphrases censées être ironiques anéantit la profondeur psychologique et l’empathie envers les personnages, et échoue à créer véritablement les dimensions humoristique, glauque et fantasque voulues du roman. Certaines expressions et syntaxes sont bizarres, presque incorrectes, ce qui fait tomber à plat toute la volonté poétique4. L’ensemble fait calculé, étudié, et froid, en fin de compte. Difficile d’éprouver de l’empathie envers l’histoire et les personnages. Texte original ou traduction trop léchée ? Notez tout de même le catalogue de littérature étrangère de Serge Safran éditeur, dont les petits livres sont élégants et confortables à lire.
Lisez aussi
Un siècle d'espoir et d'horreur, une histoire populaire du XXe siècle Chris Harman
La Fin de l'homme rouge Svetlana Alexievitch
La Supplication Svetlana Alexievitch
Le Prince jaune Vassil Barka
Purge Sofi Oksanen
Cinq histoires russes Elena Balzamo
L'homme qui savait la langue des serpents Andrus Kivirähk
Léonid doit mourir Dmitri Lipskerov
Vongozero Yana Vagner
1. Page 5.
-2. « Apparemment, c’est en toute connaissance de cause que Tobolevski épatait le public des coulisses. Il subtilisait littéralement les regards. Dans sa manière de parler ou, plus exactement, d’offrir une lecture publique aussi baroque que sonore, on ne décelait pourtant pas la moindre forgerie. Dans sa facture, la douceur et la puissance d’un ours de foire s’entremêlaient étonnement avec l’emportement d’un hobereau sais de lubie démocratique. Cette ressemblance avec un bon barine était accentuée encore par une barbe soignée, d’un apprêt digne d’un pelletier, noire, dotée de serpentines mèches grises. Tobolevski était en frac mais, au lieu de la chemise qui aurait dû aller avec, il en avait revêtu une brodée, à la russe. Sous sa glotte resplendissait un machaon de soie brodée serti d’une épingle de brillants. Il émanait de lui une douce chaleur de biscuiterie de fête, avec son glaçage de couleur. Difficile de ne pas se laisser tenter. » (pages 97-98)
-3. « À onze heures et demie nous nous arrêtâmes devant la clinique psychiatrique où se trouvait Bakatov depuis son transfèrement du poste. Laissant notre véhicule à un portail de métal gris fait de lances médiévales soudées entre elles, nous passsâmes sur le territoire de l’hôpital. Où nous fûmes rejoints par une autre personne, un gars du service de sécurité de Tobolevski. » (page 144)
« Les musiciens, malgré cela, continuaient de jouer. En s’agitant en rythme comme pour esquiver les insultes. » (page 101)
-4. « Pour le deuxième morceau j’avais complètement assimilé le clavier. Je me lançai dans la mélodie avec assez de vitesse pour que le contrôle puisse en être pris par mon dos. Comme un aveugle je relevai la tête. la vue m’abandonna, mais pour me lier au musicien imaginaire que je logeais dans ma bosse. Celui-ci se saisit de l’air, le prit en main, et les friches de ma sombre existence s’éclaboussèrent de nouveaux sons, ruisselant par mes doigts sur le clavier d’une sonate dorso-cérébrale. » (pages 84-85)
Les Ongles
(Nogti, titre original)
Traduit du russe par Stéphane A. Dudoignon
Mikhaïl Elizarov
Serge Safran éditeur
2014
176 pages
16,5 euros 3 commentaires
3 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Léchez-moi lire !