-
 Mon histoire. Une vie de lutte contre la ségrégation raciale
Mon histoire. Une vie de lutte contre la ségrégation racialeRosa Parks, avec Jim Haskins
Éditions Libertalia
2018
Rosa Parks (1913-2005) est devenue un symbole dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, mais, comme souvent, l’histoire officielle en a fait une représentation réductrice, simpliste, iconique, sortie de son contexte : un jour de décembre 1955, une femme âgée, ordinaire, épuisée par sa journée de travail, n’a pas cédé sa place à une personne blanche dans un bus ségrégué de Montgomery, en Alabama, dans le Sud des États-Unis. Que sait-on réellement de Rosa Parks ? Pas grand-chose. Cette autobiographie, rare et précieuse, inédite en français, contextualise le boycott des bus de Montgomery et la naissance du mouvement pour les droits civiques, et revient sur le parcours exceptionnel de cette femme noire militante née au début du XXe siècle dans un pays profondément raciste.
« Comme des millions d’enfants noirs avant et après moi, je me suis demandé si l’eau white avait un goût différent de celle colored, si elles avaient toutes les deux la même couleur, l’une était-elle blanche et l’autre d’une couleur différente ? »
Dans une langue très simple, Rosa Parks raconte son enfance, sa jeunesse et ses origines familiales, au début du XXe siècle dans un contexte de racisme institutionnalisé. En Alabama, dans le Sud des États-Unis, où la ségrégation est très marquée, la société est hiérarchisée, divisée et organisée de telle sorte que les Noir·es et les Blanc·hes se rencontrent assez peu. Les églises, les boutiques, les restaurants, les écoles, les transports en commun, tout est ségrégué. Son témoignage montre à quel point l’horizon des Noir·es est complétement bouché : sans cesse réduit·es à leur couleur de peau, iels ont peu d’opportunités dans la vie. Les seuls métiers qui leur sont autorisés sont mal vus, mal payés et difficiles. Les femmes peuvent devenir domestiques et les hommes chauffeurs pour les familles blanches aisées. L’école pour les Noir·es manque cruellement de moyens, et l’accès aux études supérieures est presque inexistant. En 1940, seulement 7 % des Noir·es obtiennent un diplôme de fin d’études au lycée.
Rosa Parks raconte également la peur, l’humiliation, la colère qui habitent les sien·nes ; les nuits durant lesquelles son grand-père veille devant la porte avec un fusil au cas où le Ku Klux Klan attaquerait ; ainsi que les préconisations horrifiées de sa mère : surtout, ne réponds aux provocations des petits garçons blancs, sous peine de finir lynchée ! Mais la figure du grand-père, le seul qui n’a pas peur de parler d’égal·e à égal·e avec les Blanc·hes, trace une ligne de conduite dans sa vie. Elle sent ce qui est juste et ce qui ne l’est pas, elle est fière d’elle et ne veut pas se laisser marcher sur les pieds.
« S’il y avait bien une chose qui me fatiguait, c’était de courber l’échine. »
Loin de la représentation réductrice qu’on en a fait, Rosa Parks était une femme noire militante dévouée à la cause antiraciste. Plus de dix ans avant son inculpation pour non-respect de la ségrégation dans les bus en 1955, elle était déjà secrétaire de la NAACP (Association nationale pour la promotion des gens de couleur), et son mari, Raymond Parks était clandestinement engagé dans la lutte contre la ségrégation, et plus largement contre le racisme, depuis les années 1920. Avant le boycott des bus de Montgomery, les Parks s’étaient illustré dans la lutte pour le droit de vote des Noir·es.
Puis vint le 1er décembre 1955, où cette dame « âgée » (de 42 ans seulement), « épuisée par sa journée de travail » (ou par l’oppression systémique), n’a pas voulu céder sa place à une personne blanche dans un bus ségrégué. À la suite de son procès bâclé se met en place le boycott des bus de Montgomery, utilisés à 75 % par des Noir·es (ce qui a été une des conditions de son succès). Rosa Parks raconte l’auto-organisation exemplaire des Noir·es, avec la figure émergente du pasteur Martin Luther King, pour mener un boycott efficace des bus, pendant plus d’un an, et qui donnera naissance au mouvement pour les droits civiques. Elle raconte aussi le harcèlement, les menaces de mort, les maisons des pasteurs incendiées, et finalement le meurtre de Martin Luther King.
Tout au long de son témoignage, Rosa Parks souligne combien les femmes du mouvement ont été écartées des projecteurs. Lors des rassemblements, c’était presque exclusivement des hommes qui s’exprimaient du haut de la tribune : principalement Martin Luther King, Ralph Abernathy, Edgar Nixon. La parole légitime était celle des hommes, alors que Rosa Parks a continué, durant toutes ces années, à témoigner auprès d’étudiant·es noir·es et de publics plus restreints, et à œuvrer dans l’ombre, par téléphone, par courrier, en tant que pilier de l’organisation montée pour la promotion des droits civiques. Elle redonne d’ailleurs un peu de place aux autres femmes de la lutte durant cette époque : Septima Poinsette Clark, Johnnie Rebecca Daniels Carr, Bernice Robinson, Virginia Durr.
Elle porte aussi un regard éclairé sur les méthodes de lutte : elle croit en l’efficacité de la non-violence de Martin Luther King, inspirée de Gandhi, sans pour autant en être une défenseuse inconditionnelle ; et, de ce qu’on peut lire aux débuts de leur mariage, son mari semblait partisan de la légitime défense armée. Un épisode semble l’avoir beaucoup marquée : lors de la marche de Selma en 1965, strictement encadrée par les organisateurices, elle se fait virer du cortège à plusieurs reprises parce qu’elle ne porte pas le gilet prévu pour l’événement. Un demi-siècle plus tard, certaines choses n’ont pas changé : les promoteur·ses de la non-violence peuvent se montrer toujours aussi dogmatiques, autoritaires, arrogant·es, voire ridicules…
Mon avis
C’est en particulier lorsque je tiens en main ce genre d’ouvrage, qui n’a été traduit en français qu’en 2018, c’est-à-dire un quart de siècle après sa parution aux États-Unis, que je prends conscience que notre métier d’éditeur et d’éditrice est primordial. Combien d’autres précieux morceaux d’histoire manquent-ils pour donner du corps et de l’esprit à nos luttes ? Merci aux camarades des éditions Libertalia d’avoir déniché ce texte inestimable, accompagné de notes avisées, et d’avoir rendu sa version numérique disponible gratuitement pendant le confinement : cette lecture a été salvatrice à un moment où, comme beaucoup, j’avais besoin de retrouver du sens et de l’inspiration dans mes activités.
En 2015, Paris a inauguré au nom de Rosa Parks une gare et un centre commercial (encore un grand projet inutile pour sauver la sacro-sainte croissance) dans un quartier en voie d’embourgeoisement. Mais qu’on ne s’y trompe pas : on peut y voir une façon de commémorer sa lutte, ou bien d’institutionnaliser une figure militante, érigée en icône figée, muette, vidée de sa capacité subversive, à des fins politiques : « circulez, il n’y a rien à voir, le racisme n’existe plus et l’humanisme a triomphé… » La publication de l’autobiographie de Rosa Parks est décisive contre la récupération et la langue de bois, et pour garder vivante la mémoire de nos luttes à travers les générations.
Quelques semaines après la mort insupportable, injustifiable de George Floyd, que les médias mainstream, majoritairement investis par des personnes blanc·hes, n’ont pas pu ignorer, la lecture de ce témoignage de première main met en perspective l’histoire du racisme institutionnalisé aux États-Unis, depuis l’esclavage aux discriminations de race et de classe, en passant par les crimes policiers quotidiens. Malgré les grandes valeurs répandues dans des discours grandiloquents par les classes dirigeantes, le monde est toujours profondément raciste, et les États-Unis n’y échappent pas. Gageons que le combat contre le racisme devienne la lutte fédératrice post-covid 19 !
Lisez aussi
Récits
Tant que je serai noire Maya Angelou
Assata, une autobiographie Assata Shakur
Notre case est à Saint-Denis 93 Bouba Touré
Vivre ma vie Emma Goldman
Le 16e round Rubin Carter
Littérature
À jeter aux chiens Dorothy B. Hughes
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur Harper Lee
Va et poste une sentinelle Harper Lee
L'Intérieur de la nuit Léonora Miano
Beloved Toni Morrison
L'Œil le plus bleu Toni Morrison
Americanah Chimamanda Ngozi Adichie
Voici venir les rêveurs Imbolo Mbue
L’amour de nous-mêmes Erika Nomeni
Black Girl Zakiya Dalila Harris
Essais
Le Ventre des femmes Françoise Vergès
Comment la non-violence protège l’État Peter Gelderloos
L'impératif de désobéissance Jean-Marie Muller
La Domination policière Mathieu Rigouste
La Force de l’ordre Didier Fassin
Le fond de l'air est jaune Collectif
Françafrique, la famille recomposée Association Survie
Décolonial Stéphane Dufoix
Mon histoire
Une vie de lutte contre la ségrégation raciale
Traduit de l’américain par Julien Bordier
Rosa Parks, avec Jim Haskins
Éditions Libertalia
2018
200 pages
10 euros
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
 1 commentaire
1 commentaire
-
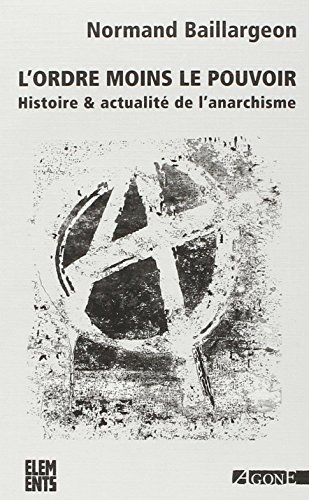
L’ordre moins le pouvoir. Histoire et actualité de l’anarchisme
Normand Baillargeon
Éditions Agone
2008
S’il y a un mot qui a été sciemment dévoyé et galvaudé, c’est bien le mot anarchisme. La pensée anarchiste a été résumée à « l’absence de gouvernement » et au chaos ; les acteur·rices et les penseur·ses ont été persécuté·es, emprisonné·es, assassiné·es et réduit·es à des terroristes poseur·ses de bombes ; la dimension libertaire des grands événements historiques (comme la Commune de Paris ou la révolution espagnole) a systématiquement été gommée des manuels d’histoire. Le travail de sape et d’occultation a été profond et durable, si bien que de nombreuses personnes de mon entourage, pourtant curieuses et passionnées, n’ont aucune connaissance théorique et pratique de ce qu’est réellement l’anarchisme. En cette période de confinement, alors que l’on s’interroge sur le monde après la pandémie du coronavirus, il me semble plus qu’urgent de vous présenter une introduction rapide et concise des aspirations libertaires.
« L’anarchisme est né d’une révolte morale contre l’injustice sociale1. » (Errico Malatesta)
Depuis la fin de la guerre froide, le communisme, avili par le stalinisme, ne fait plus rêver. Après les trente glorieuses dont les générations avant la mienne ont profité, au détriment des plus dominé·es, qu’iels soient humains ou non, le capitalisme ne fait plus rêver. L’anarchisme, pourtant écarté des médias mainstream, semble vivre un nouvel élan depuis deux décennies, et nous sommes de plus en plus nombreux·ses à voir dans ce courant la potentialité d’une vie libre, solidaire, juste, riche, épanouissante.
Voici ma définition très concise de l’anarchisme : il incarne la lutte contre le capitalisme et se veut le dépassement du libéralisme et du marxisme. Fondamentalement antiautoritaire et antidogmatique, il s’oppose à toute forme de domination, que ce soit celle de l’État2 (qui centralise le pouvoir, qui véhicule son idéologie par les médias et l’enseignement public, et qui réprime par sa police et son armée), ou celle de l’Église qui endoctrine. Il s’oppose à toute exploitation, comme le salariat qui enrichit les propriétaires des moyens de production, le patriarcat (Emma Goldman, Voltairine de Cleyre) et l’impérialisme qui asservissent la majorité de l’humanité au profit d’une minorité masculine et blanche. Largement internationaliste, antipatriotique, antimilitariste, l’anarchisme s’oppose aux guerres entre les nations, qui envoient les peuples mourir dans le seul intérêt de la classe dominante. Il dénonce l’aliénation de l’être humain par la technologie et le mythe du progrès proposés comme une solution miracle à tous nos problèmes (Jacques Ellul). L’anarchisme défend au contraire la liberté de toustes (Mikhaïl Bakounine) à disposer de sa vie et de son corps comme iel l’entend, ainsi que l’égalité, l’une n’allant pas sans l’autre : la liberté sans l’égalité, c’est le libéralisme ; l’égalité sans la liberté, c’est le communisme. La pensée libertaire revendique la libre association et le contrat social entre individus, entre communes et entre fédérations de communes, dans un mouvement allant du bas vers le haut, ainsi que l’autogestion par l’organisation des moyens de production et de consommation, comme les associations, syndicats, coopératives… (Pierre-Joseph Proudhon). L’anarchisme repose sur l’entraide (Pierre Kropotkine), l’échange, le respect de chaque être humain ou non-humain et de la nature (Élisée Reclus, Murray Bookchin), ainsi que sur l’émancipation politique, sociale, intellectuelle.
L’anarchisme n’est pas une utopie, il s’inscrit dans notre mémoire collective. Loin des manuels d’histoire officielle, ces aspirations révolutionnaires ont imprégné beaucoup de mouvements, de communautés, d’événements passés et présents, sans pour autant que le mot « anarchisme » soit prononcé (pour ne pas se définir, par peur d’être étiqueté, réprimé, censuré, par méconnaissance). Même si le concept a été théorisé au XIXe siècle, en même temps que l’essor du capitalisme, on peut vraisemblablement penser que l’anarchisme, en tant qu’organisation ou société sans hiérarchie, existe de tous temps. En Occident, on pense d’emblée à certains événements inspirants comme la Commune de Paris (1871), la révolution mexicaine (1911), la révolution russe (1918-1921), la Commune de Kronstadt (1921), ou la révolution espagnole (1936) qui reste à ce jour l’expérience libertaire ayant impliqué le plus de gens. L’anarchisme jalonne notre histoire : les créations des bourses du travail, des syndicats, des coopératives, ont permis aux travailleur·ses de s’instruire, de connaître leurs droits et de s’organiser face au patronat et au marché. Mais, récemment, plein d’expérimentations libertaires plus ou moins abouties, plus ou moins réussies, ont vu le jour : le mouvement des places publiques, les écovillages, les squats partout dans le monde ; les communautés autonomes comme celles du mouvement zapatiste au Mexique depuis les années 1990 (chronique en vue) ; le Rojava dans le Kurdistan syrien (depuis 2013), inspiré par le municipalisme libertaire de Bookchin ; le réseau des ZAD (zones à défendre) bien sûr. C’est sans compter les initiatives pédagogiques libertaires qui ont beaucoup d’importance au sein du mouvement, comme, pour ne citer que les plus connues, l’orphelinat de Cempuis (Paul Robin, 1880-1894), l’école libre de La Ruche (Sébastien Faure, 1904-1917), Summerhill (Alexander Neill, depuis 1921), l’École moderne (Francisco Ferrer, 1901-1907) qui a fait des émules.
Trop de gens croient qu’un gouvernement centralisé peut être réellement « bon » et représentatif, et qu’il est nécessaire à la formation d’une société puisque nous sommes des millions et incapables de nous autogérer. Comme cette croyance, à force d’être martelée, est perçue comme une évidence, je me permets d’émettre quelques oppositions : pourquoi devrions-nous vivre dans une société de 66 millions de personnes ? Par ailleurs, le « bon » gouvernement continuera-t-il de l’être si ses enfants cessent de lui obéir ? On nous répète sur toutes les antennes que nous sommes en « démocratie », et pourtant on peut constater l’autoritarisme de la Ve république chaque jour qui passe. Face à la richesse et à la diversité des êtres humains, des pensées et des choses, comment une structure institutionnelle centralisée pourrait-elle être représentative et régenter sans contraindre les libertés fondamentales ? Ce qu’on appelle les services publics ne sont-ils pas justement plus efficaces lorsqu’ils sont décentralisés, moins dépendants de l’administration centrale et moins attentistes envers elle ? Sommes-nous réellement incapables de gérer nos affaires nous-mêmes, ou est-ce plutôt que les plus puissant·es ont toujours fait en sorte que nous le croyions, en réprimant toute tentative historique allant dans ce sens ? Rien n’effraie plus la classe dominante que le constat qu’on peut se passer d’elle. Tous les grands bouleversements historiques ont montré que le pouvoir corrompt la meilleure des intentions et que tout gouvernement contient en son germe une forme d’autoritarisme. Pour toutes ces raisons, les anarchistes, contrairement aux marxistes, ont tendance à penser que l’insurrection viendra plus sûrement d’un peuple déterminé à se libérer de sa condition, que d’un groupe avant-gardiste et messianique ayant pris le pouvoir par la force ou par les voies légales des institutions. Pour Bakounine, si le prolétariat s’empare des institutions pour mettre en place un État révolutionnaire, même pour une période prétendument temporaire visant à accéder à une société idéale, alors il devient la nouvelle classe dominante à la suite de la bourgeoisie. Et l’histoire lui a donné raison, quelques décennies plus tard, avec la révolution russe spoliée par le totalitarisme soviétique.
« Nous repoussons toute législation, toute autorité, toute influence privilégiée, patentée, officielle et légale, même sortie du suffrage universel, convaincus qu’elle ne peut jamais tourner qu’au profit d’une minorité dominante et exploitante contre les intérêts de l’immense majorité asservie. Voilà en quoi nous sommes anarchistes3. » (Bakounine)
Mon avis
Cela fait plusieurs années que je consacre du temps à faire des recherches sur l’anarchisme, mais je ne parvenais pas à en rédiger une chronique satisfaisante : il y a tant de choses à dire ! Les lectures à ce sujet ne manquent pas, mais je ne saurais que vous conseiller L’Ordre moins le pouvoir de Normand Baillargeon, chez les éditions indépendantes Agone, qui constitue à mon sens une bonne introduction à l’anarchisme. Il est court, accessible et offre un panorama assez consistant des figures, des courants et des événements anarchistes, ainsi que de nombreuses pistes pour aller plus loin. Je trouve qu’on se repère facilement dans sa construction en trois parties. Je vous invite aussi à aller voir les conseils de lecture de ma camarade Irène du blog La Nébuleuse.
Il est difficile de rendre compte des courants très riches et divers qui traversent l’anarchisme. Comme le rappelle justement Normand Baillargeon, l’anarchisme n’est pas figé et uniforme, il n’est la propriété de personne. Au-delà des grands fondements (la lutte contre la domination et pour la liberté et l’égalité), l’anarchisme est antidogmatique par essence. C’est pourquoi le but de l’anarchiste ne consiste pas à apporter ou imposer des solutions toutes faites pour établir la société idéale, ainsi que l’explique Malatesta, mais à indiquer une méthode, à encourager chacun·e d’entre nous à s’autoformer, à organiser ou rejoindre des collectifs, associations, coopératives, etc., afin de gagner en autonomie et de tisser un réseau d’entraide solide. L’anarchisme, c’est un « ici et maintenant » qui n’attend pas de réunir les conditions idéales ; c’est une expérimentation très concrète au quotidien, et on ne peut apprendre qu’en faisant les choses par nous-mêmes.
La civilisation industrielle, la planète, ses habitant·es, le monde entier est en train de convulser. La pandémie de coronavirus est un accélérateur des effondrements écologiques, politiques, économiques, sociaux. Nous ne sommes sûr·es de rien, le pire comme le meilleur peut surgir de cette catastrophe. Le pire, on commence à le voir ces derniers mois : le totalitarisme galopant du gouvernement qui commande toujours plus d’armes et de drones pour que sa police puisse écraser le soulèvement populaire et restreindre nos libertés. La police tue toujours plus de gens chaque année, en particulier dans les quartiers ségrégés. Il n’y a rien de bon à attendre de la part des gouvernements qui ne cherchent qu’à protéger leurs intérêts économiques. En revanche, le meilleur à venir, ce sont les réseaux que nous tissons aujourd’hui, ils nous permettront de rester solidaires lors des secousses et de préfigurer le monde d’après. Protégeons-nous du gouvernement, destituons-le, ainsi que le formule le comité invisible, et organisons notre autonomie pour protéger les plus vulnérables d’entre nous. Plus nous nous impliquerons dans nos réseaux, plus nous serons en mesure de riposter aux attaques du gouvernement, de faire preuve de résilience face aux multiples effondrements, et plus nous pourrons espérer poser les bases solides d’un monde juste et sauver ce qu’il reste de la planète.
« Je veux croire que les êtres humains ont un instinct de liberté, qu’ils souhaitent véritablement avoir le contrôle de leurs affaires ; qu’ils ne veulent être ni bousculés ni opprimés, ni recevoir des ordres et ainsi de suite ; et qu’ils n’aspirent à rien tant que de s’engager dans des activités qui ont du sens, comme dans du travail constructif qu’ils sont en mesure de contrôler ou à tout le moins de contrôler avec d’autres. Je ne connais aucune manière de prouver cela. Il s’agit essentiellement d’un espoir placé dans ce que nous sommes, un espoir au nom duquel on peut penser que, si les structures sociales se transforment suffisamment, ces aspects de la nature humaine auraient la possibilité de se manifester4. » (Noam Chomsky)
Lisez aussi
Essais
"La Commune n'est pas morte" Eric Fournier
La Commune Louise Michel
La Rébellion zapatiste Jérôme Baschet
Comment tout peut s'effondrer Pablo Servigne et Raphaël Stevens
Une autre fin du monde est possible Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle
Comment la non-violence protège l’État Peter Gelderloos
La Domination policière Mathieu Rigouste
La Force de l’ordre Didier Fassin
Le fond de l'air est jaune Collectif
Boulots de merde ! Julien Brygo et Olivier Cyran
Propaganda Edward Bernays
La guerre des mots. Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie de Selim Derkaoui et Nicolas Framont
La prison est-elle obsolète ? Angela Davis
Planète végane Ophélie Véron
Le Ventre des femmes Françoise Vergès
Littérature
L’Homme au marteau Jean Meckert
Les Coups Jean Meckert
La Jungle Upton Sinclair
Mendiants et orgueilleux Albert Cossery
Les Mémorables Lidia Jorge
Retour aux mots sauvages Thierry Beinstingel
Récits
Je vous écris de l’usine Jean-Pierre Levaray
1. Page 171. -2. Ou devrait-on écrire « état », sans capitale, pour le faire descendre de son piédestal. -3. Page 63. -4. Page 200.
L’ordre moins le pouvoir
Histoire et actualité de l’anarchisme
4e édition, revue et augmentée
Normand Baillargeon
Préface de Charles Jacquier
Éditions Agone
2018 (2008)
224 pages
10 euros
Je suis une grande défenseuse de la librairie indépendante. Mais en ces temps d’isolement individuel, l’ouvrage reste disponible en PDF et en ligne sur Cairn.info pour 8 euros.
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
 votre commentaire
votre commentaire
-
 Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !
Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !
Petite histoire des résistances de la langue françaiseÉliane Viennot
Éditions iXe
2017
Pourquoi certains mots anciens comme autrice, professeuse, vainqueresse sonnent-ils si mal à notre oreille ? Le travail de recherche d’Éliane Viennot et des autres membres de la Siéfar montre qu’entre le XVIe et le XIXe siècles les masculinistes sont parvenus à invisibiliser le féminin dans la langue française. Vu l’importance du langage dans les représentations du monde et le façonnement de la pensée, la réappropriation de notre langue est essentielle pour ne pas laisser ce terrain aux masculinistes.
« Le masculin est plus noble que le féminin1 » (Louis-Nicolas Bescherelle)
L’objet de ce livre est de montrer que la langue française telle qu’on la connaît aujourd’hui est le résultat d’un récent effort des masculinistes pour asseoir leur domination, laquelle s’inscrit dans ce que l’on a appelé la « querelle des femmes », dont les débats portaient sur l’égalité entre femmes et hommes et qui a duré du XVe au début du XXe siècle. Selon Éliane Viennot, avant l’intervention et des académiciens et des pseudo-experts, la langue était effectivement genrée autour d’une construction binaire, mais elle n’était pas sexiste.
Jusqu’à la fin du XVe siècle, le français comportait peu de règles grammaticales strictes. On utilisait notamment l’accord de proximité (« Ce que le peuple a le cœur et la bouche ouverte à vos louanges2 », consistant à accorder le genre et le nombre de l’adjectif avec le plus proche des noms qu’il qualifie, et le verbe avec le plus proche des éléments formant son sujet), ainsi que l’accord des pronoms (« Madame, je suis enrhumé. Je la suis aussi, me dit-elle3 » ; consistant à accorder le pronom personnel avec le nombre et le genre des substantif), ou encore l’accord des participes présents (« Couturière, âgée de vingt-cinq ans, native de Paris, demeurante rue Neuve-Saint-Sauveur4 »). C’est sans compter l’attribution arbitraire du genre grammatical féminin ou masculin des objets inanimés (le sphinx ou la sphinx, le comète ou la comète).
Mais avec l’invention de l’imprimerie et le développement de l’accès au savoir, les élites ont commencé à normaliser la langue (l’alphabet, la ponctuation, les accents), à s’interroger sur sa capacité à instruire le peuple (mais pas trop) et à légiférer les métiers du livre (coucou mes ancêtres). Le français était jusque-là une langue vernaculaire délaissée par les érudits au profit du latin, mais la création de l’Académie française en 1635 visait justement à produire un dictionnaire national.
« Des cohortes d’académiciens sont descendus dans l’arène pour interdire autrice, avocate, écrivaine, médecine, magistrate, ministre, présidente…, mais aucun n’a jamais contesté coiffeuse, crémière ou assistante… métiers bons pour les femmes5. »
Voyant là une menace, les élites, les intellectuels, les pseudo-spécialistes ont mené l’offensive sur différents points de la langue pour consolider les privilèges des hommes en tant que classe politique. Durant plusieurs siècles, la publication de manuels de grammaire et de pamphlets, à coup d’injonctions et de recommandations, visaient à justifier l’injustifiable et expliquer l’inexplicable : « le masculin l’emporte sur le féminin ». Aucune modification n’allait de soi, elles ont été imposées en dépit de la langue, des traditions et des logiques du français, afin de consolider une idéologie discriminante.
Ce sont finalement la création de l’éducation nationale et l’industrialisation du livre au XIXe siècle qui ont imposé les règles mises au point par les masculinistes. Malgré la résistance des féministes (femmes et hommes) et des usages populaires qui ont continué, pendant plusieurs siècles, de privilégier les logiques de l’ancien français, le travail purement idéologique des masculinistes a visiblement porté ses fruits, puisque certains mots nous apparaissent comme des néologismes, alors qu’ils sont en vérité très anciens. C’est le cas par exemple du mot autrice (vilipendé par l’Académie française mais qui existe depuis le XVe siècle au moins), ou encore des mots possesseure, emperière, inventrice, jugesse, apprentisse, barbière, financière, officière, vainqueresse. Par ailleurs, des néologismes ont été créés bien qu’ils ne se justifient pas sur le plan linguistique puisque leur équivalent est attesté de longue date : auteure (autrice), professeure (professeuse), chercheure (chercheuse), défenseure (défenseuse), etc. En ajoutant un e à l’écrit qui ne s’entend pas à l’oral, ces néologismes ne semblent pas bousculer véritablement l’ordre masculin.
Mon avis
Dans ce petit ouvrage publié par les précieuses éditions iXe, Éliane Viennot, professeuse de littérature et membre de la Siéfar, montre un aspect peu connu de la « querelle des femmes » : la bataille des mots pour justifier la supériorité de la classe des hommes sur celle des femmes. La masculinisation de la langue est finalement assez récente, mais les efforts des masculinistes ont visiblement porté leurs fruits puisque des mots anciens ressemblent à des aberrations, et que certaines tournures de phrases ne nous choquent pas (pourquoi « personne n’est venu » se conjugue-t-il au masculin, dans la mesure où l’on parle d’une personne ?).
À celleux qui doutent de l’importance de retravailler la langue, prétextant qu’il y a des domaines de lutte plus décisifs pour abolir le patriarcat, je leur réponds que le langage est un instrument de domination et de contrôle de la pensée (il n’y a qu’à relire 1984 de George Orwell pour en prendre toute la mesure). Il est une marque de distinction sociale entre les élites cultivées qui savent s’exprimer correctement et celleux, volontiers dénigré·es et invisibilisé·es, qui font des « fautes ». De la même façon, les masculinistes ont contraint le langage pour opérer une division de l’humanité en deux catégories, le féminin et le masculin, traduisant l’idéal hétérosexuel des rapports humains. Si le langage n’avait pas cette puissance, pourquoi avoir créé une autorité comme l’Académie française pour le normaliser ? Pourquoi les masculinistes se seraient-ils évertués à réformer la langue dans le sens qui leur convenait ? Quel effet cela provoque-t-il sur nous, lorsque, étant petites, on nous apprend à accorder les sujets au masculin, même lorsque le sujet de la phrase comporte un homme et cent femmes ?
Le langage renferme un pouvoir de représentation du monde et de façonnement de la pensée dont on a peu conscience. Si les mots autrice et ingénieure n’existaient pas, comment pourrait-on se représenter des femmes exerçant ce métier ? Ne laissons pas la langue à ceux qui l’ont infléchie durant quatre siècles, approprions-nous-la pour déconstruire les stéréotypes, décloisonner la société, fournir à chacun·e la possibilité de se donner au monde tel qu’iel l’entend.
Le masculin s’est tellement approprié le neutre, le général et l’universalité du discours (la portée générique de « ils » tendant vers la masculinisation du monde), que le féminin, ayant la valeur du spécifique et du particulier, est finalement le seul à porter la marque du genre. Lorsqu’une locutrice s’exprime, elle est forcée de faire apparaître son genre, de se définir comme appartenant à la classe des femmes, par rapport aux individus de la classe des hommes, ce qui donne de l’importance à une partie de ce qu’elle est (son genre, son apparence, ses organes sexuels si c’est une femme cisgenre), et non pas à l’ensemble de sa personne (un être humain).
Il ne s’agit pas de valoriser les différences ou de glorifier des comportements et des activités dites « féminines », mais de bousculer la notion de genre. Le genre est un carcan, un ensemble de normes sociales rigides qui dicte ce qui est autorisé, encouragé, défendu selon que l’on appartienne au genre masculin ou au genre féminin. Outre que cela interdit la possibilité d’appartenir aux deux genres, ou à aucun, cela opère une hiérarchie entre les deux genres et un privilège masculin sur le féminin : le genre est en fin de compte un instrument de domination de la moitié des êtres humains sur l’autre. Mais, puisque le français n’a pas réellement de neutre et qu’il est fondé sur un système binaire, sa féminisation me semble indispensable dans un processus d’égalité, de visibilisation, de transparence. C’est pourquoi, à défaut d’effectuer un immense travail pour supprimer le genre grammatical dans la langue, l’écriture inclusive me paraît une solution pragmatique, efficace, logique et économique, qui contrarie les efforts masculinistes (un aperçu dans Tirons la langue). L’écriture inclusive a développé plusieurs manières de neutraliser la masculinisation de la langue : dire « ils et elles » ou « iels » ; utiliser les points médians, les parenthèses ou les traits d’union, ou comme le propose Davy Borde, inventer des mots comme les « lecteurices » ; employer des mots englobants comme « le lectorat », etc. C’est une manière de lutter à la fois dans le genre (montrer la parité dans la langue) et contre le genre (tous les métiers sont accessibles à tout le monde, il y a aussi des plombières, des caissiers, etc.).
Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce que vous utilisez l’écriture inclusive ou pas ?
Lisez aussi
Essais
Tirons la langue Davy Borde
Des femmes et du style. Pour un feminist gaze Azélie Fayolle
Moi les hommes, je les déteste Pauline Harmange
Une culture du viol à la française Valérie Rey-Robert
Le Deuxième Sexe 1 Simone de Beauvoir
Rage against the machisme Mathilde Larrère
Beauté fatale Mona Chollet
On ne naît pas grosse Gabrielle Deydier
Le Ventre des femmes Françoise Vergès
Ceci est mon sang Elise Thiébaut
Masculin/Féminin 1 Françoise Héritier
Libérées Titiou Lecoq
Non c'est non Irène Zeilinger
Nous sommes tous des féministes Chimamanda Ngozi Adichie
Manifeste d'une femme trans Julia Serano
Pas d'enfants, ça se défend ! Nathalie Six (pas de chronique mais c'est un livre super !)
Littérature et récits
Le Chœur des femmes Martin Winckler
Une si longue lettre Mariama Bâ
L'Œil le plus bleu Toni Morrison
Le Cantique de Meméia Heloneida Studart
Instinct primaire Pia Petersen
Histoire d'Awu Justine Mintsa
Une femme à Berlin Anonyme
Bandes dessinées
Camel Joe Claire Duplan
Corps à coeur Coeur à corps Léa Castor
1. Page 61. -2. Page 64. -3. Page 78. -4. Page 71 -5. Pages 113-114.
Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin !
Petite histoire des résistances de la langue française
Éliane Viennot
Éditions iXe
2017 (deuxième édition)
144 pages
14 euros
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
 2 commentaires
2 commentaires
Léchez-moi lire !






