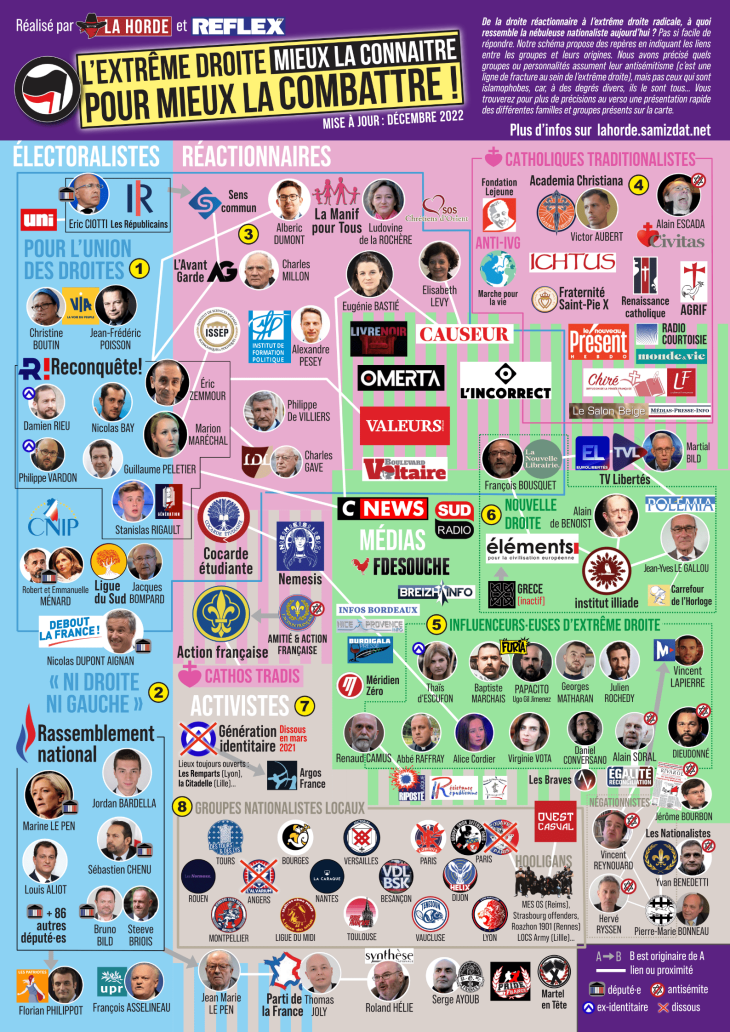-

Les Palestiniens. Lignes de vie d'un peuple
Mélinée Le Priol et Chloé Rouveyrolles
Ateliers Henry Dougier
2018
Ces derniers mois, j’entends souvent dire qu’il n’est pas possible de prendre position sur le « conflit israélo-palestinien » si on n’y connaît rien. Je pense que ce n’est pas vrai : aucune situation ne peut légitimer les horreurs que l’armée israélienne inflige au peuple palestinien depuis octobre 2023, avec la complicité de la France qui, d’une main, fournit des armes à Israël, et de l’autre, écrase toute manifestation de solidarité à l’égard d’un peuple assassiné.
Mais pour mieux comprendre ce génocide, j’ouvre un cycle de chroniques sur la colonisation israélienne qui dure depuis un siècle. Voici un ouvrage court, accessible, qui est à mon sens un excellent point de départ, car il rend aux Palestinien·nes ce qu’on leur a volé : leur humanité.
« Il faut témoigner de cette société qui n’a pas sombré dans la barbarie malgré l’occupation israélienne, montrer ce miracle1. » (Karim Kattan)
Les Palestiniens. Lignes de vie d’un peuple, écrit par les journalistes Mélinée Le Priol et Chloé Rouveyrolles, est un recueil de témoignages et d’entretiens de Palestinien·nes de Cisjordanie, de Gaza, de différents camps de réfugié·es en Égypte et au Liban, et même de Palestinien·nes qui vivent en Israël (iels constituent 20 % de la population israélienne et sont appelé·es « Arabes israëliens », « Palestinien·nes de l’intérieur » ou « Palestinien·nes de 1948 »).
Iels sont ancien·nes combattant·es pour la liberté, militant·es, universitaires, médecins, artistes, entrepreneur·ses, membres d’ONG, ouvriers. Quelques-un·es sont connu·es en France, comme Leïla Khaled (militante au Front populaire de libération de la Palestine), la cinéaste Annemarie Jacir (née en 1977 dans la région de Bethléem), ou encore Karim Kattan (écrivain franco-palestinien, qui livre le mot de la fin).
Ces récits, de quelques pages chacun, donnent à voir les aspects historiques, politiques, religieux, culturels et économiques d’un territoire colonisé depuis un siècle par Israël. L’introduction, très synthétique et limpide, permet d’avoir en tête quelques éléments historiques clés, comme la création de l’état d’Israël et l’exode massif des Palestinien·nes, appelé la Nakba (« catastrophe » en arabe) en 1948, et la guerre des Six-Jours en 1967 ; deux événements qui ont participé à l’émergence du nationalisme palestinien. D’autres éléments historiques sont mentionnés, comme les deux Intifada, avant et après les accords d’Oslo en 1993 qui ont mené à la création de la mal nommée Autorité palestinienne.
Ce recueil de textes fournit quelques bases pour comprendre les enjeux : le symbole de la terre et de la figure paysanne aux yeux d’un peuple plusieurs fois déraciné, le chômage de masse (40 % en Cisjordanie en 2018), l’économie palestinienne perfusée par les aides internationales et paralysée par Israël, l’importance des traumatismes (40 % des hommes palestiniens sont allés en prison, pour y être humiliés, torturés et violés)...
Comment se construire en tant qu’individu au sein d’un peuple de « vaincu·es2 », profondément marqué par l’exil, les traumatismes ; un peuple considéré comme terroriste ? Qui sommes-nous pour juger les Gazaoui·es, qui vivent dans une prison à ciel ouvert, dans la région la plus densément peuplée au monde3, dans la misère et la peur, lorsqu’iels emploient la violence en légitime défense ? Comment vivre librement sa sexualité et ses passions dans une société traditionnelle, conservatrice, patriarcale et gagnée par le mouvement islamiste ?
Comment faire perdurer la culture de la résistance, ce que les Palestinien·nes appellent le sumud (« ténacité », « tenir bon »), quand la perspective d’une amélioration de la situation s’amenuise de génération en génération ?
Mon avis
Depuis octobre 2023, au moins 38 000 personnes ont été tuées à Gaza, en grande majorité des civil·es et des enfants (la moitié de la population a moins de 20 ans), mais un article récemment paru dans la revue scientifique The Lancet estime à 186 000 le nombre de morts directes et indirectes à Gaza depuis cette date. Plus de 88 000 personnes ont été blessées, des milliers d’autres sont portées disparues, probablement ensevelies sous les décombres, sans compter les 2 millions déplacées. Endeuillées, affamées, mutilées, torturées, violées et traumatisées à vie.
Pour l’état d’Israël, l’horreur des attentats du 7 octobre 2023 menés par le Hamas a été le prétexte pour éradiquer définitivement l’enclave de Gaza, pour parachever une extermination de masse et l’accaparement de cette terre qui a commencé il y a un siècle.
Derrière ces chiffres qui défient l’entendement, il y a des vies intimes, des familles, des gens comme vous et moi. Que sont devenues les sœurs Walaa, Asmaa et Husna, âgées de 19 à 28 ans en 2018, qui vivaient dans la bande de Gaza ? Ont-elles pu réaliser les rêves qu’elles ont confiés aux deux journalistes, ou ont-elles péri sous les 70 000 tonnes de bombes lâchées par Israël depuis octobre 2023 ?
L’ouvrage de Mélinée Le Priol et Chloé Rouveyrolles constitue, à mon sens, une excellente entrée en matière pour comprendre la Palestine et la colonisation israélienne. Je regrette seulement que nous ne sachions pas comment les personnes ont été rencontrées et choisies pour témoigner.
L’indifférence et l’inaction tuent. Collectivement, nous avons une responsabilité, nous devons exprimer notre refus de la colonisation et notre soutien envers tous les peuples opprimés. Car céder à la déshumanisation des Palestinien·nes, c’est perdre notre propre humanité.
Lisez aussi
Essais
Edward Bernays Propaganda
Mathieu Rigouste La Domination policière
Peter Gelderloos Comment la non-violence protège l’Etat
Chris Harman Un siècle d'espoir et d'horreur, une histoire populaire du XXe siècle
Association Survie Françafrique, la famille recomposée
Littérature
Émilie Tôn Des rêves d’or et d’acier
Alice Zeniter L’Art de perdre
Les Palestiniens. Lignes de vie d’un peuple
Mélinée Le Priol et Chloé Rouveyrolles
Ateliers Henry Dougier
2018
144 pages
14 euros
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
Suivez-moi sur Instagram !
1. Page 127. -2. Page 62. -3. Plus de 2 millions de personnes sur un territoire de 365 km2.
 1 commentaire
1 commentaire
-
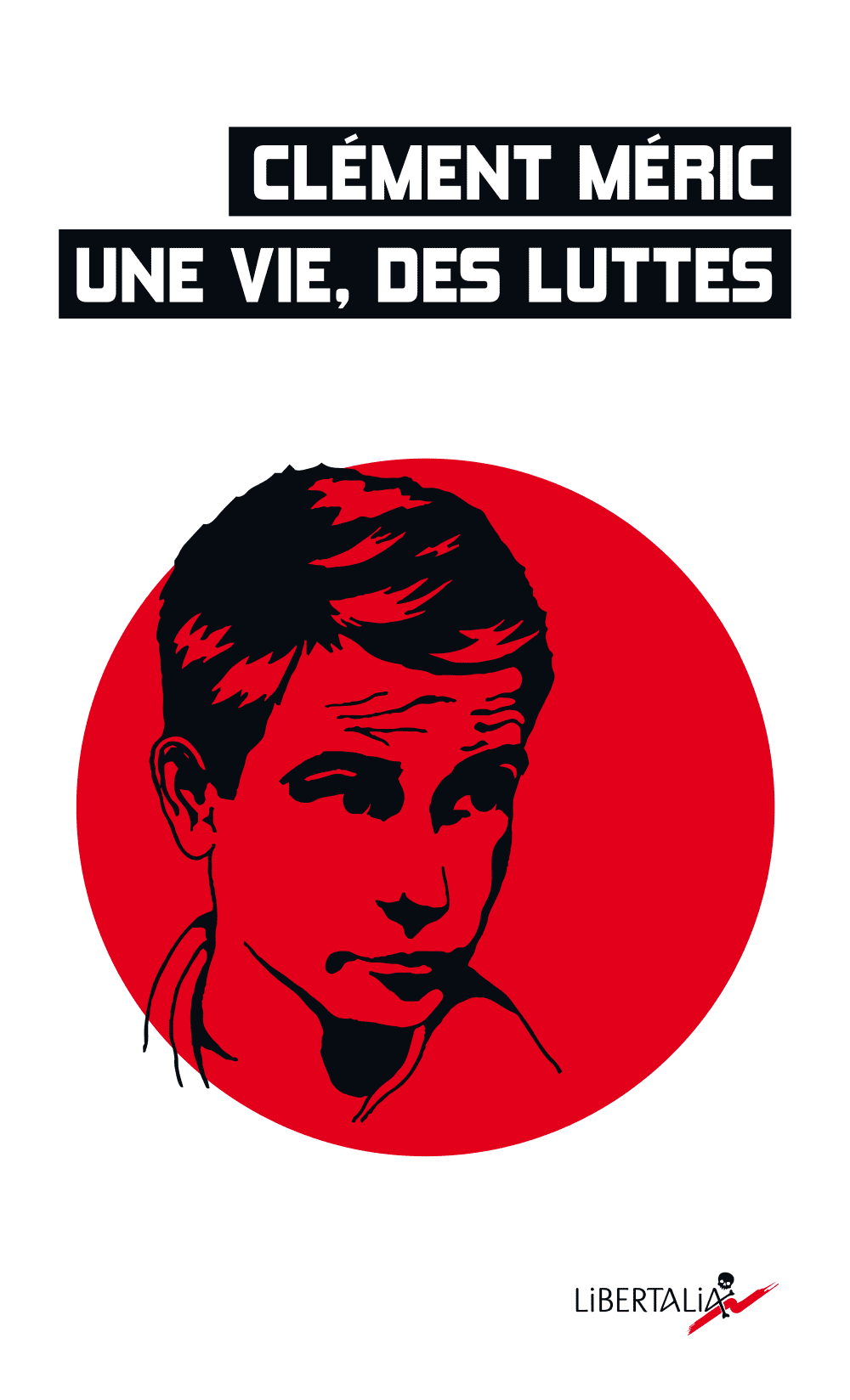
Clément Méric. Une vie, des luttes
Collectif
Éditions Libertalia
2023
Il y a 11 ans, le 5 juin 2013, Clément Méric, 18 ans, mourait sous les coups de fachos, en pleine journée, dans une rue animée de Paris. Qui était-il ? Que s’est-il vraiment passé ? Comment son meurtre a-t-il été traité médiatiquement ? Ce petit ouvrage est tout à la fois un hommage à Clément Méric et un appel à la lutte contre le fascisme, le racisme, le nationalisme et le repli identitaire qui sont aux portes du pouvoir pour ces élections législatives anticipées.
« Il ne prônait pas la violence : ce qui l’intéressait était de réunir les gens, de réfléchir avec eux, d’organiser des concerts1. »
Dans une première partie, ses proches s’attachent à présenter Clément Méric, un jeune étudiant de 18 ans, déjà très politisé et très cultivé pour son jeune âge.
Il était antifasciste, antispéciste, syndicaliste révolutionnaire, anarchiste, et s’était engagé (entre autres) au sein du groupe Action antifasciste Paris-Banlieue (AFA-PB). Il soutenait les luttes LGBT (notamment celle pour le mariage pour toustes, dont parle Rozenn Le Carboulec dans Les Humilié·es) et les luttes des quartiers populaires. À son âge, je n’en faisais pas autant !
« Il faisait passer sa pratique avant les étiquettes et se plaçait délibérément dans une position d’exécutant, refusant obstinément d’avoir une posture de décision. Il était aussi capable, et c’est une qualité extrêmement rare dans ce milieu, de se mettre en retrait sur des questions qui le concernaient sans le concerner directement, typiquement les questions féministes, parce qu’il croyait en l’autogestion, en la nécessité de s’organiser entre premier·ères concerné·es, ici les femmes ou des personnes non hétérosexuelles2. »
« Nous voulons un Hitler français3 » (Samuel Dufour)
Cet ouvrage décrit minutieusement l’agression et la mort de Clément Méric, et dément chacune des idées couramment véhiculées autour de ce meurtre. Clément et ses amis voulaient-ils en découdre avec les skinhead néonazis à la sortie du magasin, principalement Samuel Dufour, Esteban Morillo et Alexandre Eyraud (tous âgés de la vingtaine au moment des faits) ? Les fachos ont-ils utilisé des poings américains ?
Clément Méric est-il mort parce qu’il était en rémission d’une leucémie déclarée en 2011, comme certain·es ont eu la malhonnêteté de le prétendre ? Quel rôle a joué Serge Ayoub, la figure de proue du groupe fasciste Troisième voie, dont faisaient partie les agresseurs ?
« Désormais, dans l’analyse dominante, [les antifas] vont être confondus avec les fascistes dans une même réprobation des extrêmes4. »
Les premiers jours après la mort de Clément Méric, l’émoi est général. Mais, comme on peut s’y attendre, la fachosphère a commencé son entreprise de désinformation, d’autant plus que, comme le raconte Rozenn Le Carboulec dans Les Humilié·es, sa parole s’est libérée depuis La Manif pour tous.
Chaque camp y va de son analyse, la droite comme la gauche républicaine renvoient dos à dos les fachos et les antifas, mettant sur le même plan violence et légitime défense. La figure de l’antifasciste est criminalisée, réduisant son combat à une querelle de territoire, quand il n’y a pas une dépolitisation pure et simple de l’affaire, présentée comme une « rixe » entre deux bandes rivales qui aurait mal tourné.
Les agresseurs néonazis ont pourtant été entendus et condamnés, bien qu’ils aient fait appel, et le groupe d’extrême droite radicale Troisième Voie de Serge Ayoub a été dissous.
Mon avis
Ce petit ouvrage est tout à la fois un hommage à Clément Méric, paru à l’occasion des 10 ans de sa mort en 2013. Mais il n’est pas le seul à être victime du fascisme. Le meurtre du rugbyman argentin Federico Martin Aramburú à Paris en 2022 n’a pas suscité d’émoi en dehors de nos sphères militantes, et les attaques de personnes racisées par des groupuscules fachos sont de plus en plus fréquentes.
Cet ouvrage est aussi un appel à la lutte antifasciste. Nous devons comprendre cette mouvance qui cultive la haine, la violence, le racisme, la misogynie et l’autoritarisme, nous devons comprendre comment elle s’est banalisée. Nous devons contrer ses discours médiatiques (par l’éducation populaire) et ses attaques bien réelles (par une autodéfense physique).
Que l’extrême droite investisse ou non le pouvoir le 7 juillet prochain, cette période politique nous envoie un signal fort : face au repli identitaire et au racisme de plus en plus décomplexé, nous devons absolument nous mobiliser et nous organiser sur le temps long. Plus nous serons organisé·es dans des collectifs, des associations, des syndicats, des partis politiques, mieux nous pourrons nous protéger des attaques et expérimenter une société égalitaire, émancipatrice et solidaire. Car le mouvement antifasciste n’est pas simplement une riposte à l’extrême droite, il s’inscrit dans un combat plus large contre le capitalisme, le patriarcat, le validisme, l’écocide…
« Les idées d’extrême droite se combattant aussi par l’éducation et la formation. Concrètement, ce n’est pas si simple, mais pointer les stéréotypes dans les conversations du quotidien, relever les raccourcis et les jugements à l’emporte-pièce, dénoncer les fake news est un boulot de fourmi incontournable5. »
Cet ouvrage soulève aussi des questions fondamentales sur les réponses à donner à ce meurtre, et que je compte explorer avec d’autres ouvrages : la prison est-elle efficace (spoiler : non) ? La dissolution d’un groupe d’extrême droite suffit-elle à faire disparaître cette mouvance (non plus) ?
Merci aux proches et camarades de Clément Méric d’avoir eu le courage d’écrire ce livre, et aux éditions Libertalia de l’avoir publié. Les droits d’auteurice sont reversés au Collectif pour Clément.
« Clément vit dans nos luttes, combattons le fascisme6. »
Lisez aussi
André Koulberg Le FN et la société française
Peter Gelderloos Comment la non-violence protège l’Etat
Éric Fournier "La Commune n'est pas morte"
Louise Michel La Commune
Paul Ariès Écologie et cultures populaires
Nos rêves ne tiennent pas dans les urnes
Normand Baillargeon L’ordre moins le pouvoir
Jérôme Baschet La rébellion zapatiste
Manuel Cervera-Marzal Les Nouveaux Désobéissants : citoyens ou hors-la-loi ?
Collectif Le fond de l'air est jaune
Angela Davis La prison est-elle obsolète ?
Mathieu Rigouste La Domination policière
Clément Méric. Une vie, des luttes
Collectif
Éditions Libertalia
2023
240 pages
10 euros
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
Suivez-moi sur Instagram !
1. Page 51. -2. Page 57. -3. Page 99. -4. Page 140. -5. Page 193. -6. Page 150.
 2 commentaires
2 commentaires
-
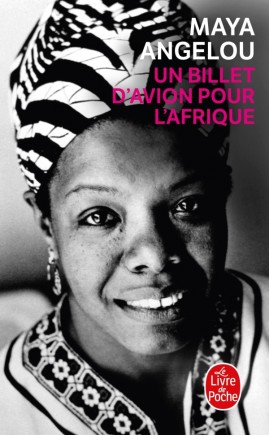
Un billet d’avion pour l’Afrique
Maya Angelou
LGF
2012
Pour les dix ans du décès de Maya Angelou (1928-2014), je vous présente ce récit autobiographique, dans lequel elle raconte son expérience au Ghana avec son fils. Comme d’autres Noir·es américain·es dans les années 1960, elle a ressenti le besoin de se rendre en Afrique, sur les terres natales de ces ancêtres victimes de l’esclavage. Cependant, la lecture de ce récit sera plus nettement plus appréciable si vous avez déjà lu son œuvre phare, Tant que je serai noire.« Nous étions des Noirs américains en Afrique de l’Ouest, où, pour la première fois de notre vie, la couleur de notre peau était considérée comme normale et naturelle1. »
Lorsque Maya Angelou arrive au Ghana avec son fils Guy âgé de 17 ans, Kwame Nkrumah (1909-1972) vient d’être élu premier président de la toute jeune république du Ghana. En revendiquant l’anticolonialisme et le panafricanisme, il porte en lui les plus grands espoirs et une immense fierté.
« Au Ghana, un cadavre non réclamé justifiait l’attention des médias et une réponse émotive de la part d’Efua, tandis que, en Amérique, des corps noirs encore bien vivants n’avaient pas droit à de tels égards. Trop souvent, parmi nous, la vie se monnayait à vil prix et la mort encore plus. Depuis la fin de l’esclavage, des Noirs américains avaient couru, marché, fait du stop et vagabonder d’endroits intenables en endroits insupportables et étaient morts dans des prés, des prisons, des hôpitaux, des champs de bataille, des lits et des granges. Et s’ils étaient nés dans la douleur, seuls les mourants avaient conscience de leur mort. Ils venaient et disparaissaient, non pris en compte, sinon par les traditions symboliques, et non réclamés, sinon par le sol où ils redevenaient poussière2. »
À l’instar de ses ami·es expatrié·es noir·es américain·es qu’elle appelle les « révolutionnaires du retour3 », Maya Angelou a besoin de se rendre en Afrique, sur la terre de ses ancêtres, pour renouer avec ses racines coupées par trois siècles de colonisation. Inévitablement, Maya Angelou s’interroge sur ses origines africaines. De quelle région d’Afrique ses ancêtres ont-iels été arraché·es ? Les gens qu’elle croise aujourd’hui dans les rues d’Accra sont-ils des descendants des esclavagistes africains ?
« Je me demandais si les Noirs de la diaspora, moi la première, pourraient vraiment réintégrer l’Afrique. Avant même d’arriver, nous portions, tel un collier, des squelettes de désespoir séculaire et nous étions marqués au fer par le cynisme. En Amérique, nous dansions, riions, procréions ; nous devenions avocats, juges, législateurs, instituteurs, médecins et prêcheurs, mais nous conversions sous nos glorieux habits l’insigne d’une histoire barbare cousue à notre peau foncée4. »
Elle s’imagine que l’Afrique va les accueillir comme une mère qui retrouve ses petit·es. Mais comme elle ne connaît ni la langue ni les coutumes locales, ce voyage est finalement un saut dans l’inconnu qui ne laissera pas indemnes ses croyances et ses rêves. Trouvera-t-elle sa place au Ghana ? Que peut-elle apporter à ce pays ?
« Si on ne nous acceptait pas au Ghana, la nation la plus progressiste d’Afrique noire, où trouverions-nous un port5 ? »
À Accra, la capitale du Ghana, elle navigue sans trop de mal entre les milieux intellectuel, artistique militant, diplomatique et rural. Mais c’est compter sans le manque des États-Unis où elle est née, et son fils, son « gouvernail6 », qui cherche à quitter son giron à mesure qu’il devient adulte.
« Nous, révolutionnaires du retour, dansions au Lido au son du High Life, nous déhanchions comme si nos hanches n’allaient plus jamais nous servir, buvions de la bière Club en discutant de ce que nous pouvions apporter au Ghana, à sa révolution et au président Nkrumah. Nous vivions à fond, à fond la caisse. Le temps était une horloge remontée à cran et nous nous efforcions de profiter pleinement de chaque moment d’ivresse7. »
Mon avis
J’ai découvert Maya Angelou, autrice, chanteuse, danseuse et militante noire-étatsunienne, avec son œuvre phare, Tant que je serai noire. J’ai lu avec curiosité Un billet d’avion pour l’Afrique, dans lequel elle met à nu ses espoirs et ses déceptions en arrivant au Ghana.
Aux États-Unis comme au Ghana, Maya Angelou a côtoyé la grande histoire en luttant pour la dignité des Noir·es. À Accra, elle a rendu hommage à W.E.B. Du Bois lorsqu’il est mort en 1963, et soutenu Malcolm X à son retour de La Mecque.
Dans ses écrits, elle n’élude pas non plus sa vie de femme, de personne noire et de mère qui a dû élever seule son enfant. Cependant, sa personnalité franche, fougueuse, révoltée, féministe et résolument moderne apparaît de manière plus éclatante dans Tant que je serai noire. C’est pourquoi je vois davantage Un billet d’avion pour l’Afrique comme une lecture complémentaire, mais dépendante de son œuvre principale. Si l’histoire de Maya Angelou vous intéresse, je vous conseille de commencer par Tant que je serai noire, et continuer avec ses autres récits !
Lisez aussi
Récits
Rosa Parks Mon histoire
Assata Shakur Assata, une autobiographie
Rubin Carter Le 16e round
Makan Kebe « Arrête-toi ! »
Littérature
Toni Morrison Beloved
Toni Morrison L'Œil le plus bleu
Chimamanda Ngozi Adichie Americanah
Hemley Boum Les Maquisards
Zakiya Dalila Harris Black Girl
Dorothy B. Hughes À jeter aux chiens
Harper Lee Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur
Léonora Miano L'Intérieur de la nuit
Léonora Miano Crépuscule du tourment
Léonora Miano Contours du jour qui vient
Léonora Miano Tels des astres éteints
Léonora Miano Les Aubes écarlates
Erika Nomeni L’amour de nous-mêmes
Essais
James Baldwin Retour dans l’oeil du cyclone
Stéphane Dufoix Décolonial
Peter Gelderloos Comment la non-violence protège l’État
Chris Harman Un siècle d'espoir et d'horreur, une histoire populaire du XXe siècle
Jean-Marie Muller L'impératif de désobéissance
Christelle Murhula Amours silenciées. Repenser la révolution romantique depuis les marges
Association Survie Françafrique, la famille recomposée
Françoise Vergès Le Ventre des femmes
Bande dessinée
Wilfrid Lupano et Stéphane Fert Blanc autour
Un billet d’avion pour l’Afrique
Mémoires
(All God’s Children Need Traveling Shoes)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Lori Saint-Martin et Paul Gagné
Maya Angelou
Le Livre de poche
2020 (2012 pour le premier dépôt légal)
264 pages
7,30 euros
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
Suivez-moi sur Instagram !
1. Page 11. -2. Pages 235-236. -3. Page 29. -4. Page 99. -5. Page 103. -6. Page 13. -7. Page 101.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Léchez-moi lire !