-
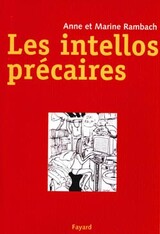
Les Intellos précaires
Anne et Marine Rambach
Éditions Fayard
2001
L’intello, précaire ou flexible ?Sous ces deux termes en apparence antinomiques se cache une réalité sociale et économique. La précarité de l’intellectuel est le résultat d’une politique orientée vers la rentabilité à tout prix, au profit de l’actionnariat et au détriment de la dimension humaine et sociale de l’entreprise (sauf lorsqu’il s’agit d’une jeune structure ou d’une association, elle-même précaire, qui induit celle de ses intellos).
À défaut d’avoir fait une analyse sociologique en bonne et due forme, Anne et Marine Rambach ont sorti du placard l’une des conséquences du régime capitaliste que nous absorbons chaque jour à petite dose : l’externalisation des compétences. Au même titre que la délocalisation, la baisse de la qualité au mépris de la sécurité et de la santé du travailleur et du consommateur, la recherche impérative de la croissance économique (par l’obsolescence programmée ou l’injection de dépendance), la précarité est une réponse économique pour être rentable et conquérir toujours plus de place sur les « marchés » ultra-concurrentiels.
Ceux qui investissent sur les biens, les services et les êtres humains pour bâtir leur fortune l’appellent flexibilité et mobilité. Pour ceux qui la subissent – et ils sont certainement majoritaires – c’est la précarité. Les CDI, s’ils ne sont pas raflés par un plan social, sont progressivement remplacés par des travailleurs à domicile, des free lance (ou des auto-entrepreneurs) dont les charges sociales et les contraintes sont inexistantes ; les journalistes sont plus compétents lorsqu’ils sont pigistes, car moins sédentaires ; même les CDD sont remplacés par des stagiaires qui occupent à tour de rôle un poste à l’année.
Dans cette logique ultra libérale, ce sont évidemment les entreprises qui tiennent d’une main de fer le rapport de force avec les nombreux candidats à la précarité (à défaut d’avoir pu mettre les deux pieds dans l’entreprise avec un CDI utopique, ou au moins un CDD).
« Les stagiaires : catégorie bénie ! Si soumis, si disciplinés, de bonne volonté, pas fiers, travailleurs, et qui ne coûtent rien. Besoin d’une assistante ? C’est fait. Bac + 5, bilingue, connaît déjà le boulot, pour environ 13 francs de l’heure, sans charges sociales. Qui dit mieux1 ? »
Grâce à la précarité, les entreprises suppriment leur devoir de nourrir, de protéger et d’assurer la retraite de leurs salariés. Désormais, on dispose et on impose selon les besoins immédiats de l’activité. Désormais, les salariés, tout comme leurs outils de travail et leurs locaux (bref, leurs conditions de travail), ne représentent plus un investissement mais seulement une charge ; on investit plus que dans les actions et les fonds financiers.
Et parmi les employeurs visés, Anne et Marine Rambach s’en prennent violemment au premier d’entre eux : l’État, qui abuse des CDD consécutifs, des postes vacataires et se permet des retards de paiement.
La précarité induit une concurrence extrême entre les précaires qui se battent pour une pige ou une traduction payée au lance pierres ; la précarité tue les droits sociaux et la sécurité de l’emploi que chacun mérite en échange de sa force de travail (qu’elle soit physique ou intellectuelle). La précarité tue la solidarité, muselle les travailleurs qui n’existent pas sur les plans social, économique, politique et médiatique. Ces travailleurs n’existent même pas pour les organismes publics, comme la Sécurité sociale et le Pôle emploi, ce qui entraîne des flous plus ou moins artistiques en termes de rémunération.
Cette non-représentation permet aux entreprises de continuer, en toute impunité, à piocher dans le tas de précaires pour remplir les tâches sous-investies ; les précaires eux-mêmes ne se reconnaissaient pas en tant que tels, avant cette enquête, et ne se sont jamais syndiqués (mais par qui ?). Et la concurrence entraîne le nivellement par le bas des tarifs des piges, des feuillets, des heures d’enseignement qui rémunèrent les intellos précaires :
« Le précaire précarise le précaire2. »
L’intello précaire, un « ovni social3 » ?
« Errant de stand en stand en compagnie d’autres amis précaires pendant l’inauguration du Salon du livre 2001, dans la grande halle de la porte de Versailles, nous nous demandions combien d’intellos précaires squattaient alors l’endroit. On critique souvent les pique-assiettes qui hantent les cocktails. Pense-t-on que certains d’entre eux trouvent ainsi leur principal repas ? Un jeune pigiste de Technikart expliquait ses stratégies pour se nourrir toute la semaine en courant de buffet en buffet. Ce soir-là, comme des volées de moineaux, nous dévalisâmes le traiteur du Seuil avant de jeter notre dévolu sur celui des éditions Robert Laffont. Comme nous étions mêlés à la foule, notre illégitimité était indétectable ; nous emportions nos provisions pour les dévorer à l’ombre d’une plante verte ou derrière une tablée de livres... Cependant, cette année, manquant de bonnes adresses (la chaleur, sans doute), nous éclusâmes surtout du champagne, ce qui nous conduisit à un état d’euphorie sans doute injustifié4. »
Qui sont les intellos précaires ? Auteurs, journalistes, traducteurs, rewriteurs, éditeurs, illustrateurs, photographes, scénaristes mais aussi chercheurs et enseignants, ils ont fait de longues études (de bac + à bac + 8) mais n’ont pas trouvé d’emploi fixe. Ils sont passionnés par leur métier et ont choisi de l’exercer sans considération des difficultés économiques à venir.
Le mode de vie précaire engendre une succession de comportements plus ou moins volontaires : ils sont polyvalents et hyper-travailleurs, ils effectuent tantôt des travaux dits « alimentaires », tantôt des travaux qui les passionnent, parfois dans des secteurs radicalement opposés, ce qui permet difficilement de les comptabiliser. Bernard Lahire, dans La Condition littéraire, évoque cette « schizophrénie sociale5 » (que Bernard Lahire appelle « double vie »), puisque les auteurs sont en première ligne de la précarité des diplômés. Rares sont ceux qui vivent de leur écriture (Marc Lévy, malheureusement...) et la grande majorité exerce des métiers sans rapport direct avec leur passion de l’écriture.
Ils vivent dans l’instant présent (selon les contrats qui se présentent) et cumulent un fort capital symbolique et des activités culturelles chronophages, au croisement entre les obligations du métier et la passion. L’intellectuel précaire se doit d’entretenir son réseau, car sans lui il n’est rien, puisqu’il lui permet de décrocher les contrats – et c’est probablement la plus grande difficulté des nouveaux intellos précaires.
La précarité est bien souvent financière (d’où le développement du système D et de pratiques illégales) mais aussi statutaire : comment se projeter dans l’avenir si, à chaque instant, on est menacé de perdre des contrats ? Vivre avec quel argent en cas d’« accidents de la vie » ? Et comment avoir une retraite, quand l’activité professionnelle n’ouvre aucun droit ?
Mais la précarité n’est pas forcément subie ; elle peut être un choix et présente des avantages, surtout quand le CDI en entreprise n’est plus le modèle économique qui séduit les jeunes générations. « Le modèle du travail salarié ne veut plus de nous ? Ça tombe bien : nous ne voulons plus de lui6 ! » L’entreprise est une désillusion : elle engendre le stress, le mal-être, le harcèlement moral, la sédentarité. Il faut respecter les codes sociaux et vestimentaires, veiller à éviter les conflits relationnels, et travailler dans des conditions de travail souvent mal vécues et qui ne laissent pas de place à la créativité et à l’originalité. L’entreprise est perçue comme une micro-société violente psychologiquement, où la guerre pour le pouvoir est perpétuelle ; le mode de fonctionnement est perçu comme rigide et sclérosé.
Les intellos précaires ont des beaux métiers : être auteur pour donner à voir au-delà des apparences, être journaliste pour défendre la cause des opprimés ; être traducteur pour donner le texte à l’universalité ; être rewriteur pour permettre au texte de rencontrer le plus grand nombre de lecteurs ; être éditeur pour incarner le lien indispensable entre l’auteur et son lectorat. Nobles métiers, ô combien prestigieux ! « Surtout dans l’édition où tout le monde se la pète un peu parce qu’on fait des livres, pas de la pâtée pour chiens7. »
Oui, mais ! Anne et Marine Rambach pointent du doigt ce qu’elles appellent le grand écart social : les métiers sont valorisés socialement mais pas du tout financièrement. Et souvent, le prestige social fait office de rémunération ; comme si l’on ne se nourrissait exclusivement que des honneurs.
Et tandis que les télespectateurs du journal télévisé de 20 heures admirent (il n’y a pas de quoi) l’élocution des journaleux chiens de garde (à défaut d’être intègres, ils baignent dans le prestige), une multitude de journalistes triment pour aligner 100 grammes de viande dans leur frigo (et pourtant, ils ne sont pas moins doués et moins dignes de réussir que leurs confrères). L’intello précaire, qui effectue des menus tâches de rédaction, fait du remplissage ; on délègue le fond, mais c’est souvent la forme qui compte (et paie) le plus. Alors d’un côté, une poignée d’intellos reçoit les honneurs et les salaires souvent démesurés par rapport à la qualité du travail ; de l’autre, une armée (mais l’armée est plus solidaire que les précaires) déconsidérée et précarisée.
Mon avis
Les autrices, précaires et beaucoup diplômées elles-mêmes, assument pleinement leur démarche subjective : on écrit forcément de quelque part et elles ne s’en cachent pas.
Elles ne sont pas sociologues mais ont mené une série d’entretiens qualitatifs avec des dizaines d’intellos précaires. Elles racontent les témoignages, ponctués de leur propre expérience, avec beaucoup d’humour, même s’il est parfois grinçant, tout en ayant un propos politique sur la question de la précarité. Au résultat, le livre se lit facilement, grâce aux récits qui alimentent cet ouvrage en diversité et surprises, mais l'ensemble manque aussi de structure à cause de ces entretiens. S'il pêche par un amalgame de tous les secteurs, lesquels ont des points communs mais méritent d’être traités séparément : mais leur second livre, Les Nouveaux Intellos précaires, publié en 2009, revient en détail sur chacun.
Cet ouvrage a fait de grandes vagues lors de sa sortie : enfin, un statut était accordé à une population aux limites floues, mais dont les caractéristiques étaient précises. Certes, il a été écrit voilà plus de dix ans ; certaines mesures légales ont évolué, mais il dégage une réalité sociale et économique intéressante. Elles terminent également sur l’explication de cette précarité : ce serait en partie dû au conflit générationel avec les anciens soixante-huitards, désormais bien implantés dans les entreprises, et qui ne veulent pas céder du terrain aux nouveaux diplômés.
Des mêmes autrices
Les Nouveaux Intellos précaires
Lisez aussi
La Condition littéraire Bernard Lahire
Édition. L’envers du décor Martine Prosper
Correcteurs et correctrices, entre prestige et précarité Guillaume Goutte
Journalistes précaires, journalistes au quotidien Collectif (100e chronique du blog)
Tribulations d’un précaire Iain Levison
Boulots de merde ! Enquête sur l'utilité et la nuisance sociales des métiers Julien Brygo et Olivier Cyran
1. Page 224. -2. Page 204. -3. Page 30. -4. Page 73. -5. Page 133. -6. Page 104. -7. Page 205.
Les Intellos précairesAnne et Marine Rambach
Fayard
2001
332 pages
18,25 euros
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
 votre commentaire
votre commentaire
-

La Condition littéraire. La double vie des écrivains
Bernard Lahire
Éditions La Découverte
2006
L’écrivain, un professionnel du livre
À partir d’une enquête menée auprès d’écrivains de toutes les régions de France, quels que soient leur secteur éditorial et leur notoriété, Bernard Lahire a dressé la sociologie des conditions pratiques de l’écrivain en vue de le « matérialiser ». Dans une société utilitariste, l’écrivain exerce une activité non rémunératrice et pourtant très chronophage : en fait, il est le seul acteur du système à ne pas être considéré comme « professionnel du livre ».
Les écrivains, partagés entre un « second métier » pour subvenir aux besoins matériels et une forte disposition à l’écriture, sont frustrés et mènent ce que Bernard Lahire nomme la « double vie ». Or, il apparaît dans les courtes notices biographiques des dictionnaires que l’existence des écrivains se réduit à leur appartenance à l’univers social spécifique de la littérature, sans que les conditions extérieures à l’écriture ne soient prises en compte. Pourtant celles-ci, qu’il s’agisse de répondre à une commande ou de préférer un genre plus rémunérateur qu’un autre, jouent un rôle essentiel dans le métier d’écrivain.
La population des écrivains
Qui sont-ils ? Premier constat, et non pas des moindres, les écrivains sont majoritairement des hommes. Les femmes sont presque totalement écartées des prix littéraires : au prix Goncourt, elles représentent 9,8 % des prix entre 1903 et 2004 ; 10,7 % des prix Interallié entre 1930 et 2004 ; 12,7 % des Renaudot entre 1926 et 2004. Et même pour le prix Femina, les femmes ne représentent que 35,6 % des prix entre 1904 et 2001. Par ailleurs, compte tenu de l’âge moyen de publication du premier texte à 33,5 ans, et de la première publication sous forme de livre à 40,7 ans, l’éditeur préfère publier de « jeunes » auteurs dont il pourra suivre les publications futures.
D’autre part, les écrivains ont un niveau de diplôme élevé dans l’ensemble. S’il n’existe pas d’école spécialisée de la littérature, à la différence des nombreux autres domaines artistiques majeurs, en revanche une loi tacite du jeu littéraire implique une haute formation.
La nécessité d’un second métier
La difficulté de « vivre de sa plume », topoï de la littérature, témoigne d’un grand paradoxe : les écrivains, qui sont pourtant au cœur de la création, sont considérés comme les moins « professionnels » parce qu’ils sont le maillon de la chaîne du livre qui vit le moins de la création. Pour preuve, la répartition du prix du livre illustre ce paradoxe : l’auteur ne perçoit son droit d’auteur que si le livre se vend, tandis que les autres « professionnels » se rémunèrent quel que soit le succès rencontré auprès du public.
Cependant, une majorité d’écrivains choisit l’auto-mécénat : en l’absence d’héritage, le second métier permet de vivre économiquement et de se consacrer en toute indépendance à la littérature, sans avoir à se tourner vers l’écriture des genres rémunérateurs. Pour reprendre les propos de Jean-Jacques Rousseau, « rien de vigoureux, rien de grand ne peut partir d’une plume toute vénale1 ».
Gilles Maurice Dumoulin (sous les pseudonymes de G. Morris ou Vic Saint Val), définit explicitement son métier : « Prostitué(e)s, nous le sommes tous, auteurs de romans policiers, d’espionnage, d’action, d’anticipation, de suspense, puisque nous devons pour nous vendre, flatter les goûts de notre clientèle2. »
Quel est ce second métier ? La plupart des écrivains exercent un métier dans le monde littéraire mais hors jeu littéraire, comme éditeur, directeur littéraire, correcteur, traducteur, responsable de revue ou attachés de presse, ou bien travaillent dans l’enseignement ou le journalisme.
Toutefois, la « double vie » s’accompagne souvent d’une certaine précarité. Si Henry Murger considérait la Bohème comme le stage de la vie artistique, ou de toute la vie comme le souligne justement Bernard Lahire, car la Bohème se transforme en précarité si l’écrivain souhaite vivre de sa plume. La situation instable et le manque de certitudes quant aux revenus posent problème en cas de maladie, de décès, de retraite, de chômage…
Mon avis
Qui sont-ils ? Comment travaillent-ils ? Quel est leur second métier ? Si les six cents pages sont impressionnantes au premier abord, les propos de Bernard Lahire sont abordables pour tout lecteur désireux de mieux connaître les profils et les conditions de vie de l’écrivain. Les chapitres bâtis autour de chaque thème commencent par une analyse illustrée par les témoignages d’auteurs ; pour les lecteurs intéressés par la méthode d’analyse sociologique, le livre regroupe en fin de volume le questionnaire confié aux participants et l’ensemble des statistiques ayant servi à l’analyse.
En conclusion, c’est un ouvrage qui met en lumière une vérité rarement entendue et qui modifie en profondeur la perception du monde du livre.
On aurait pu penser que Bernard Lahire opérait un dédoublement en ne s’incluant pas dans l’analyse, or, même s’il est auteur lui aussi, l’écriture est étroitement liée à son premier métier : publier des recherches sociologiques. De fait, il n’entre pas tout à fait dans la même problématique que les auteurs littéraires dont il a étudié la situation et peut se mettre en retrait concernant la « double vie », mais il est également concerné par la précarité propre aux métiers de l’intellectuel.
Lisez aussi
Édition. L'envers du décor Martine Prosper
La Trahison des éditeurs Thierry Discepolo
Correcteurs et correctrices, entre prestige et précarité Guillaume Goutte
L'Edition sans éditeurs André Schiffrin
Les Intellos précaires Anne et Marine Rambach
Les Nouveaux Intellos précaires Anne et Marine Rambach
1. Page 140. -2. Page 419.
La Condition littéraire. La double vie des écrivains
Bernard LahireÉditions La Découverte
Collection Texte à l’appui
2006624 pages
25,40 euros
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
 votre commentaire
votre commentaire
-

La Tache
Philip Roth
Éditions Gallimard
2002
Un roman fourre-tout
La Tache, le vingt-quatrième roman de Philip Roth (sans compter ses autres travaux), ressemble à un agglomérat de thèmes et de personnages qui lui tenaient à cœur et qu’il n’était pas parvenu à caser dans un précédent roman.
Coleman Silk, le doyen de l’université d’Athena, en Nouvelle-Angleterre, est un professeur reconnu de littérature antique, qui, du jour au lendemain, est accusé de propos racistes. Sans le soutien de la part des professeurs de sa génération, rejeté par les plus jeunes, il se retrouve seul sur le banc des accusés, à une époque où le racisme est fustigé. Vaincu, il prend sa retraite et vit isolé.
C’est en 1998 que l’écrivain Nathan Zuckermann, le héros de quelques uns des romans de Philip Roth, rencontre Coleman, son voisin à présent retraité, et s’intéresse de près à son histoire. La narration, qui fait de Nathan le témoin du naufrage personnel d’un autre personnage, est on ne peut plus classique : parfois, le « classique » a du bon ; parfois non. Les personnages « tiennent debout » davantage parce qu’ils sont brisés par un passé tragique que parce qu’ils sont décrits avec succès par Philip Roth (et la traductrice).
À travers Nathan qui raconte à la première personne, on découvre que Philip Roth ressort une énième fois la topique de l’identité : Coleman Silk n’est pas ce qu’il donne à voir. À l’âge adulte, il a enterré au fond de son être un secret, que ni sa femme ni ses enfants ne connaissent, au prix du sacrifice. Cet homme, en se réinventant, met en scène le rêve américain. Comment, lorsqu’on est défavorisé par une origine sociale ou ethnique, parvient-on à s’élever au-delà des « handicaps » et à réaliser son rêve ?
Par ailleurs, l’individu qui occupe de hautes fonctions sociales ou professionnelles se doit d’avoir une vie privée irréprochable (marié et bon père de famille) ; et lorsque la vie privée entache l’image de l’homme publique, les répercussions sociales, familiales et psychologiques peuvent être irréparables. Philip Roth a su capter l’air du temps et le puritanisme américain. Mais il a également ajouté à l’ensemble une petite touche faussement contestataire (« c’était mieux avant ») surtout à partir du dernier quart, longtemps après que l’intrigue soit tassée – quand le livre tarde vraiment à se fermer.
Mon avis
Dans ce brassage des valeurs américaines et de personnages déchus, l’intrigue est pesante, laborieuse ; on s’attarde sur une multitude de détails qui auraient chacun donné une intrigue s’ils avaient été aboutis. Mais ce foisonnement ne fait pas la richesse de l’œuvre, elle est plutôt comme une grosse valise fourre-tout peu passionnante. L’intrigue est désordonnée, mal soutenue. Les scènes glissent les unes aux autres avec difficulté : il n’y a pas d’élément déclencheur qui redonne un souffle à la narration pour s’immerger dans une autre époque, ou dans la psychologie d’un autre personnage. Au contraire, l’ensemble est dissout et manque souvent de clarté avec la confusion des conjugaisons.
On réunit pèle-mêle des personnages et des thèmes dont on pense qu’ils peuvent coexister, et on les relie à l’histoire et à la psychologie des Américains, comme c’est le cas ici avec l’affaire Bill Clinton-Monica Lewinsky.
Il n’est pourtant pas nécessaire de redoubler de rebondissements pour conquérir le cœur du lecteur. Le jeu des mots, leur intensité peuvent porter à eux seuls l’intrigue. Ici, ni les mots ni les événements ne font écho. Mais quelques passages sortent du flot inconsistant, comme ceux qui concernent Les Farley, atteint du stress post-traumatique du Vietnam.
Au résultat, si les thèmes « classiques » ont toujours quelque chose à transmettre, par-delà les pays et les époques (on a bien écrit un milliard d’histoires d’amour sans qu’elles se ressemblent), ici ils tombent mollement. L’écriture souffre peut-être du filtre de la traduction : les mots ne sont pas ceux que Philip Roth a choisis, et les lecteurs français ne sont pas forcément investis à ce point des questions identitaires et raciales comme l’ont été les Américains.
Lisez aussi
Demande, et tu recevras Sam Lipsyte
Littérature d'Amérique du Nord
La Tache
Philip Roth
The Stain (titre original)
Traduit de l’anglais par Josée Kamoun
Éditions Gallimard
Collection Du monde entier
2002
448 pages
22,50 €
Pour ne pas manquer les prochaines chroniques, inscrivez-vous à la newsletter !
 votre commentaire
votre commentaire
Léchez-moi lire !






