-
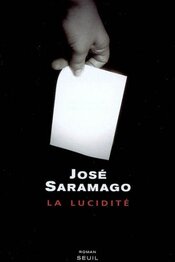
La Lucidité
José Saramago
Seuil
2007
Et si, lors des présidentielles municipales, les électeurs de la capitale votaient majoritairement blanc ?
« Les électeurs avaient toute la journée pour voter, ils attendaient sans doute que le mauvais temps passe1. »
Le résultat tombe : lors des élections présidentielles municipales d’un pays sans nom, qui pourrait être le Portugal, 83% des électeurs de la capitale ont voté blanc. Surprenant, inexplicable, injustifié, intolérable ! s'écrient les hommes politiques davantage attachés à leurs sièges électoraux qu’aux désirs du peuple.
Déterminé à ne jamais se remettre en question, le gouvernement instaure un état d’exception, car enfin, cet acte n’est autre qu’une atteinte à la légitimité de la démocratie et à la sécurité de l’État ; pire ! c’est une insurrection, une rébellion ! Afin de rétablir l’unité nationale et la cohésion, le gouvernement entame une grande enquête où tous les moyens seront mis en œuvre pour découvrir quelle organisation secrète a bien pu fomenter le vote blanc… Aux grands maux, les grands remèdes : il s’agit de rétablir la sacro-sainte démocratie et de ramener les ouailles au bercail.
Mon avis
La Lucidité de José Saramago incarne tout à fait la littérature politique et engagée en dressant une critique de la démocratie représentative. Les ministres, dénoncés pour leur incompétence, leur opportunisme, leur interchangeabilité et leur soif de pouvoir, ignorent totalement les préoccupations et les revendication des citoyens. Lorsque 83 % des électeurs de la capitale, bientôt appelés les « Blanchards », votent blanc aux élections présidentielles municipales, c’est perçu comme un acte de rébellion à l’encontre de la « démocratie » à éradiquer au plus vite. Saramago montre comment la démocratie représentative, sous couvert d’artifices électoraux, se révèle autoritaire pour continuer à faire croire à sa légitimité.
Les médias ne sont pas épargnés : dépeints comme de véritables chiens de garde au service du gouvernement, ils sont les instruments de la propagande et multiplient les discours de l’idéologie dominante.
La démocratie telle qu’on la vit à l’heure actuelle ne donne la parole qu’à la population privilégiée. Comme les attentats de janvier 2015 l’ont montré, les débats sont vides de sens, reposant sur des concepts, des valeurs, des idéologies jamais définis, qui font le terreau des amalgames. Chaque personnage public y va de son discours et de ses solutions, dans une logorrhée enflammée et démagogique, alors que ce sont les citoyens anonymes qui devraient les premiers s’exprimer et débattre de ces questions. Saramago le démontre en révélant comment les intentions des « Blanchards » ne sont jamais analysées ni comprises par le gouvernement, dans une totale déconnexion avec le peuple.
Saramago ne s’arrête pas là, puisqu’il travaille sur la langue, sur la symbolique qu’on donne aux mots en utilisant les majuscules. Fidèle à son identité littéraire, il insère les dialogues, sans ponctuation, à l’intérieur même du récit et aime multiplier les circonlocutions : ce procédé déroutant, souvent agaçant, ne plaira pas à tout le monde, mais il détonne dans le paysage littéraire.
Par ailleurs, si le principe de base de ce roman politique est excellent, le déroulement de l’histoire est inégal, axé sur différents groupes de personnages laissés ensuite en chemin. D’autre part, le récit, écrit en 2007, ne pouvait pas intégrer le voyeurisme et l’intelligence collective des réseaux sociaux. Leur impact est pourtant phénoménal, car ils rendent les mouvements sociaux plus transparents et nourrissent les rumeurs et les manipulations psychologiques.
Si l’absence d’internet et des réseaux sociaux rend l’histoire irréaliste, La Lucidité est tout de même un roman hyper intéressant sur le plan politique. À force d’être déresponsabilisés, nous finissons par croire que l’élection d’une élite est indispensable pour que la démocratie existe. Mais le peuple est capable de vivre en harmonie dans un espace commun, et la vraie démocratie est participative, avec des représentants en dialogue avec des comités de citoyens.
1. Page 15.
Du même auteur
Lisez aussi
Nos rêves ne tiennent pas dans les urnes Paul Ariès
Opinion, sondages et démocratie Roland Cayrol
Rêve général Nathalie Peyrebonne
Les Renards pâles Yannick Haenel
Nous aurons de l'or Jean-Eric Boulin
Les Mémorables Lidia Jorge
Éloge de la démotivation Guillaume Paoli
L’ordre moins le pouvoir Normand Baillargeon
Saramago, l'entretien par Didier Jacob
La Lucidité
(Ensaio sobre a Lucidez, titre original)
Traduit du portugais par Geneviève Leibrich
José Saramago
Seuil
2007
360 pages
22 euros 6 commentaires
6 commentaires
-
 Salon du livre de Paris 2015
Salon du livre de Paris 2015 O Matador
Patrícia Melo
Albin Michel
1996
À la suite d’une petite provocation qui a dégénéré en meurtre, Maïquel, un jeune homme de São Paulo, devient tueur à gages pour des hommes riches et influents.
« J’ai sorti mon arme et j’ai tiré, je l’ai eu en pleine tête1 »
Tout commence par une provocation, une vanne lancée comme ça. Mais Maïquel, un jeune homme de 23 ans, n’aime pas plaisanter et nous le dit tout net : il provoque le rigolo en duel et l’abat de sang froid.
Maïquel n’a pourtant rien d’un dur. Bouffé par la culpabilité et la gravité de son geste, il s’enfuit en courant et se terre quelques jours chez lui. Paniqué, il laisse libre court à ses pires cauchemars : les flics, les juges, la prison… Les jours passent, et rien ne se passe ! Ou plutôt si : les voisins déposent des cadeaux sur le pas de la porte. Plus étonnant encore, lorsqu’il sort enfin de chez lui et qu’une patrouille de police passe devant lui, celle-ci s’arrête et le salue avec respect. Mais pas de menottes, pas d’arrestation… Alors, sa vie bascule.
« Les autres ont surtout apprécié le moment où j’ai martelé la tête d’Ezéquiel et où je lui ai crevé les yeux. Les mères ont adoré et moi j’ai trouvé normal qu’elles adorent. Les cadeaux ont été encore plus beaux que quand j’avais tué Suel, des jumelles, cinq kilos de riz, un morceau de rumsteck, des cartes, des lunettes de soleil, des tee-shirts, et plein de babioles2. »
« Avant d’être une ordure j’étais autre chose, j’étais un homme, j’étais bon3. »
Maïquel, presque malgré lui, est devenu un tueur à gages et bienfaiteur de la ville. Engagé par le riche Dr Carvalho qui le paie pour tuer les « nègres », les pauvres voleurs, violeurs et dealers. Dans son délire sécuritaire, le Dr Carvalho ne se contente plus de barricader sa belle résidence, de blinder ses portes et d’entraîner ses chiens féroces. Il lui faut tuer la vermine, ces pauvres désespérés que Maïquel assassine avec le consentement de la police corrompue. Maïquel honteux de ses chaussures plates et usées sur le grand tapis moelleux du Dr Carvalho, se permet à présent de rêver à une maison à soi, une voiture, une femme, des enfants… Passer de l’autre côté de la barrière et devenir riche : mais à quel prix ?
Maïquel se glisse dans la peau du tueur à gage sans états d’âme ni remord, mais en réalité il n’est pas taillé dans le marbre. À coups de feu, il ingurgite la haine qu’on veut lui faire avaler, la haine de son propre peuple, et la haine de lui-même. Jusqu’à son paroxysme.
Pour finir
Si O Matador de Patrícia Melo semble commencer comme une parodie du tueur à gages débutant et maladroit, on se rend compte que, malgré l’ironie du sort qui pointe, il n’en est rien. Maïquel représente la jeunesse de São Paulo pauvre, abandonnée par les pouvoirs publics, vouée à dealer, se droguer, ou avoir un job de merde sans espoir d’ascension sociale. À travers lui, on entrevoit une jeunesse fracassée avant même d’avoir passé la vingtaine. La misère, le racisme, la violence, la maladie, la mort ; ici le temps est plus court du berceau à la morgue.
Mais O Matador pointe aussi les jeunes riches désorientés, cloisonnés dans leurs banlieues chics, à travailler et consommer comme papa et maman alors que la violence gronde à l’extérieur.
Pour Maïquel, les emmerdes s’accumulent en toute impunité, dans une escalade vertigineuse qui atteint son paroxysme. La culpabilité le bouffe, le ronge, le tue et on s’attend au pire à chaque page. Raconté à la première personne, sur le ton de l’urgence, sans ponctuation de dialogue, O Matador est un roman social fracassant.
De la même autrice
Lisez aussi
Bahia de tous les saints Jorge Amado
Manuel pratique de la haine Ferréz
Le Cantique de Meméia Heloneida Studart
Le Bourreau Heloneida Studart
Wakolda Lucía Puenzo (littérature argentine)
Les Veuves du jeudi Claudia Piñeiro (littérature argentine)
Littérature d'Amérique du Sud
1. Page 146. -2. Page 78. -3. Page 116.
O matador
Traduit du portugais (Brésil) par Cécile Tricoire
Patrícia Melo
Albin Michel
Collection Les grandes traductions
1996
304 pages
18,60 euros
Disponible aussi en poche 2 commentaires
2 commentaires
-
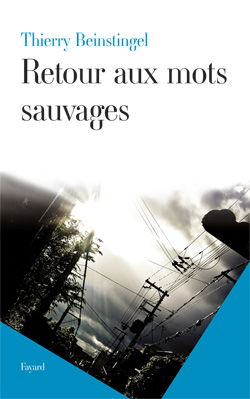
Retour aux mots sauvages
Thierry Beinstingel
Fayard
2010
Suite à une reconversion forcée, « Éric », la cinquantaine, a troqué ses outils d’électricien pour devenir téléopérateur.
« Bonjour, que puis-je faire pour votre service1 ? »
Celui qu’on appelle le « nouveau », ou encore « Éric », prénom qu’il a du choisir selon les conventions de l’entreprise, fait son premier jour en tant que téléopérateur. À cinquante ans, lui qui était électricien, a été forcé à se reconvertir dans une entreprise encore plus loin de son domicile. C’était téléopérateur ou chômeur.
Sans considération pour ce qu’il est, ce qu’il a été dans sa vie, il découvre alors la déshumanisation et la robotisation du travail à la chaîne. « Éric » enchaîne les appels des clients en suivant un protocole ultra précis, qui établit pour lui toute une liste de réponses toutes faites, générant parfois des dialogues incohérents. Peu à peu, ses mains perdent leurs cornes, la peau s’adoucit, les ongles se lissent. Sa bouche, à force de parler dans le vide, s’assèche.
Chaque semaine, les objectifs marketing ciblent les services à vendre aux clients, quels que soient leurs véritables besoins. Les objectifs sont si importants qu’ils ne laissent pas de place aux rapports humains entre collègues. Il n’a pas déjà raccroché avec un client, dont il ne saura jamais s’il a été satisfait, qu’un autre client l’attend au bout de la ligne.
La pression est constante, au point qu’une vague de suicides frappe l’entreprise. Avec la pression des managers, le harcèlement des clients au téléphone, les conditions de travail deviennent encore plus dures.
Un jour, dans la perte d’identité, le délitement du lien social, « Éric », en homme consciencieux, prend une initiative et rappelle un client.
Pour finir
Le Retour aux mots sauvages, c’est le téléopérateur, esclave moderne dont chaque phrase est dictée par un protocole précis, qui tente d’exister malgré son travail. Répétitif, insupportable, déshumanisant à l’extrême, le métier de téléopérateur est un des derniers que le libéralisme n’a pas encore réussi à supprimer à coup de technologies ultra novatrices et révolutionnaires. Chaque jour, les téléopérateurs interchangeables subissent l’agressivité des clients mécontents et des managers qui attendent des objectifs de rentabilité ; ils vivent dans la peur et dans l’angoisse.
Le téléopérateur, c’est l’épiphénomène le plus visible, le plus exacerbé, d’un modèle d’entreprise profondément ancré dans le libéralisme ; ce modèle qui place la rentabilité au centre de l’entreprise et considère l’humain comme une variable d’ajustement comme une autre. Le pouvoir de collectivité des travailleurs a été anéanti, avec la baisse d’influence des syndicats et le rapport individualiste avec le travailleur, qui négocie seul ses droits avec l’entreprise.
Le malaise au travail est une composante de plus en plus banale avec laquelle l’être humain devrait s’accommoder. Travailler, c’est souffrir ; jusqu’à la dépression, jusqu’au suicide. Dans Retour aux mots sauvages, Thierry Beinstingel dénonce le voyeurisme des médias et la violence des clients harceleurs après une vague de suicides dans la télécommunication (on en parle moins, mais il y en a toujours).
« Je me suicide à cause de mon travail. À cause de. Origine, fondement, raison, motif. Retour brutal aux mots sauvages2. »
Face au malaise de plus en plus flagrant, la réponse managériale est une injonction au bonheur, avec ce positivisme factice qui fait gerber : soyez heureux de travailler pour nous, nous travaillons dans la bonne humeur, nous sommes réunis sous les mêmes valeurs ! S’il épouse l’entreprise à coups de « culture d’entreprise », il sera moins enclin à se retourner contre son employer ou à se suicider. Tous les petits rituels sont bons pour créer cette fausse convivialité, qui n’a pour seul but que de faire augmenter la productivité et avaler la dure pilule au travailleur : tu travailleras dur, longtemps et pour un salaire de misère !
« Un employé heureux est plus performant, un salarié malheureux ne crée pas de valeur : phrases réelles, publiées lors des tristes événements, autant de preuves d’un totalitarisme entièrement dévoué au profit, corps et âme3. »
La réponse d’« Éric », le protagoniste de Retour aux mots sauvages, est peut-être de ne pas se fondre totalement dans le moule, mais d’impulser ses propres manières de faire, d’imposer son caractère au poste qui nous est confié. Il ne faut pas sous-estimer l’impact de quelqu’un sur l’ensemble du groupe. C’est aussi de faire attention aux mots qu’on emploie, qu’on entend, qu’on reprend à notre compte, et à leur sens véritable.
Dans la lignée de la littérature prolétarienne, Retour aux mots sauvages est un roman captivant. Seulement, la forme n’est pas totalement convaincante. De la part d’un professionnel des télécommunications, on pouvait attendre davantage de profondeur dans l’analyse psychologique et dans le fonctionnement de l’entreprise. Ce manque de profondeur tient probablement de ce procédé littéraire souvent utilisé — rendre « Éric » anonyme pour dénoncer cette déshumanisation — et qui contribue à ne pas s’attacher au protagoniste, malgré l’immersion du monologue intérieur renforcée par la suppression des tirets et des guillemets autour des dialogues. Mais, malgré ce choix littéraire impersonnel, il y a cette manière de cadencer ses phrases, de créer le rythme avec les verbes, qui l’emporte, et qui donne un grand plaisir à la lecture de ce roman aux thèmes graves.
Lisez aussi
L’Homme au marteau Jean Meckert
L’Employé Guillermo Saccomanno
En crachant du haut des buildings Dan Fante
"La Commune n'est pas morte" Eric Fournier
La Tête hors de l’eau Dan Fante
Trois hommes, deux chiens et une langouste Iain Levison
Tribulations d’un précaire Iain Levison
Un petit boulot Iain Levison
Un job pour tous Christophe Deltombe
Je vous écris de l'usine Jean-Pierre Levaray
La Fille derrière le comptoir Anna Dubosc
Boulots de merde ! Julien Brygo et Olivier Cyran
La guerre des mots. Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie de Selim Derkaoui et Nicolas Framont
1. Page 109. -2. Page 105. -3. Page 106.
Retour aux mots sauvages
Thierry Beinstingel
Éditions Fayard
2010
304 pages
19 euros
Disponible aussi en poche 2 commentaires
2 commentaires Suivre le flux RSS des articles
Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires
Suivre le flux RSS des commentaires
Léchez-moi lire !


